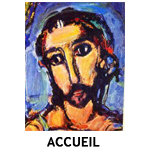Tourisme : Rio de Janeiro

« La chevauchée des Walkyries » dans les haut-parleurs pour l’atterrissage ! Et avant, dans l’avion, J’ai faim, puis Atlantide, puis Jurassic Park III (une daube).
Vingt minutes d’attente à la douane pour ne pas même ensuite avoir mes bagages fouillés. Type européen + « I am here for business” = “passez, monsieur”. Je note que le prix des taxis de l’aéroport a baissé de 15%. Etonnifiant. Et me revoilà pour la quatrième fois traversant la cidade marevillosa de nuit. Je commence à reconnaître les itinéraires, la « linha vermelha » (la « ligne rouge », l’autoroute qui relie la gare routière au nord à l’aéroport puis file vers l’est), le tunnel sous le Corcovado, l’avenue le long de la lagune (lagoa Rodrigo de Freitas) et mon bon vieux quartier (bairro) d’Ipanema, célèbre pour ses girls, pardon ! ses « garotas ». Ses ragazze, si vous préférez.
A la réception de l’hotel, je suis reconnu, salué. Bientôt une star. Welcome back et tout ça. Et enfin, enfin, ma chambre et la douche chaude que la revue d’Air France recommande de prendre à la descente des longs courriers pour faire circuler le sang. Sans doute pour éviter le « syndrome de la classe économique » qui fait, selon les journalistes, s’effondrer les passagers par centaines dans les terminaux et les passerelles, victimes d’embolies, de caillots mal placés, etc. Au point que les médecins contre-attaquent dans la presse, en faisant valoir qu’il y a un ou deux morts par an dans le monde à cause de ce truc là, et qu’on fait vraiment beaucoup de bruit pour presque rien. Théoriquement, je suis intouchable : je voyage en business. Mais l’on ferait bien de parler aussi d’un syndrome de la classe affaire, qui suit l’ingestion forcée de champagne et de repas fins. Quant au syndrome de la first et les ravages que le caviar entraîne, qui aura le courage d’en parler ? Qui évoquera le gros ventre, la cellulite, l’alcoolisme précoce ? L’alcoolisme qui tue tout de même plus de monde que les caillots de la classe éco, ouarf ouarf ouarf.
Ayant donc évité l’embolie de justesse, je peux aller me coucher. Je suis suffisamment fatigué pour que le jet lag ne m’éveille pas à cinq heures. André, à neuf, est fatal à mon sommeil : je suis en bas, tu descends ? Et zou, off to S*** et ma première journée de boulot.
Le soir, je ne résiste pas à une invitation d’André et sa ravissante épouse ***. Nous mangeons du poisson et des fruits de mer chez « Marius crustaceos » au bord de la plage à Leme (c’est ainsi que l’on appelle le bout septentrional de Copacabana). Le lieu est propice aux touristes, et les prix sont outrageusement chers même pour Rio : du 250 francs par personne, c’est presque Maxims ! Peu importe, c’est bon. Buffet froid (huitres, palourdes, saumon fumé), buffet chaud (spécialité bahianaise sans nom, paella, soupe aux poissons) et serveurs qui passent parmi les tables (langoustes, mais je suis déjà trop plein !). J’aurais du m’en douter : André, avec ses lunettes Armani et son portefeuille Pierre Cardin, a un je-ne-sais quoi de Nelly-esque qui me va bien, jusque dans le choix de ses restaurants. Et je ne suis pas encore allé deux fois dans le même avec lui.
A côté de nous, un brésilien raconte à une argentine, sa copine, l’histoire de l’indépendance du Brésil. André, en bon Portugais, fronce le sourcil : ce n’est pas comme ça qu’il voit les choses, lui ! J’apprends au passage que les Brésiliens détestent les Argentins, plus encore que les Portugais détestent les Espagnols.
Et me revoilà dans ma chambre, en me jurant de ne plus accepter un repas à Rio le premier soir : je suis plein et fatigué : là, le jet-lag est sans pitié.
Le lendemain
Rien de bien folichon : du boulot, notre personnel local s’améliore, et au dodo tôt après une salada caprese. Lorsque je ne mondanise pas avec la gentry portugaise d’Ipanema, j’ai découvert qu’une salade mangée dans la chambre est le meilleur des repas en déplacement. Vite pris, pas lourd, et pas trop cher, ce qui fait plaisir au patron (surtout après les folies d’hier où j’ai invité tout le monde). Salada caprese, donc, mais avec une caiprinha, on ne va quand même pas se laisser abattre. Un petit tour au business center pour lire mes mails perso et sévir sur le forum de Xavier Arnaud. Ce jour 18, Rome vient de réintégrer officiellement dans l’Eglise la fraction lefevriste de Campos, 28 000 fidèles, à 300 km d’ici, et un évêque schismatique. Le cardinal Castrillon Hoyos s’est déplacé, les évêques de Niteroi (de l’autre côté de la baie) et de Teresopolis aussi. Bien que pas directement et viscéralement lefévristes (l’évêque, Mgr Licinio Rangel, n’est pas un des quatre sacrés par Mgr Marcel en 88), leur cœur, et probablement aussi leurs lectures, leur formation, tout était de ce côté. C’est désormais fini, et l’on peut les considérer comme les premiers lefevristes à réintégrer l’Eglise. Deo Gratias, donc !
(NDS : et cerise sur le gâteau, Mgr Rifan Mgr Rifan, bras droit de Mgr Rangel , est consacré à Campos le 18 août 2002 par le Cardinal Castrillon Hoyos (cf photo), assisté de Mgr Rangel et d'un évêque brésilien : il s'agissait là du premier sacre épiscopal ,approuvé par Rome et célébré selon le Rite traditionnel ... depuis le Concile Vatican II)
Vingt minutes d’attente à la douane pour ne pas même ensuite avoir mes bagages fouillés. Type européen + « I am here for business” = “passez, monsieur”. Je note que le prix des taxis de l’aéroport a baissé de 15%. Etonnifiant. Et me revoilà pour la quatrième fois traversant la cidade marevillosa de nuit. Je commence à reconnaître les itinéraires, la « linha vermelha » (la « ligne rouge », l’autoroute qui relie la gare routière au nord à l’aéroport puis file vers l’est), le tunnel sous le Corcovado, l’avenue le long de la lagune (lagoa Rodrigo de Freitas) et mon bon vieux quartier (bairro) d’Ipanema, célèbre pour ses girls, pardon ! ses « garotas ». Ses ragazze, si vous préférez.
A la réception de l’hotel, je suis reconnu, salué. Bientôt une star. Welcome back et tout ça. Et enfin, enfin, ma chambre et la douche chaude que la revue d’Air France recommande de prendre à la descente des longs courriers pour faire circuler le sang. Sans doute pour éviter le « syndrome de la classe économique » qui fait, selon les journalistes, s’effondrer les passagers par centaines dans les terminaux et les passerelles, victimes d’embolies, de caillots mal placés, etc. Au point que les médecins contre-attaquent dans la presse, en faisant valoir qu’il y a un ou deux morts par an dans le monde à cause de ce truc là, et qu’on fait vraiment beaucoup de bruit pour presque rien. Théoriquement, je suis intouchable : je voyage en business. Mais l’on ferait bien de parler aussi d’un syndrome de la classe affaire, qui suit l’ingestion forcée de champagne et de repas fins. Quant au syndrome de la first et les ravages que le caviar entraîne, qui aura le courage d’en parler ? Qui évoquera le gros ventre, la cellulite, l’alcoolisme précoce ? L’alcoolisme qui tue tout de même plus de monde que les caillots de la classe éco, ouarf ouarf ouarf.
Ayant donc évité l’embolie de justesse, je peux aller me coucher. Je suis suffisamment fatigué pour que le jet lag ne m’éveille pas à cinq heures. André, à neuf, est fatal à mon sommeil : je suis en bas, tu descends ? Et zou, off to S*** et ma première journée de boulot.
Le soir, je ne résiste pas à une invitation d’André et sa ravissante épouse ***. Nous mangeons du poisson et des fruits de mer chez « Marius crustaceos » au bord de la plage à Leme (c’est ainsi que l’on appelle le bout septentrional de Copacabana). Le lieu est propice aux touristes, et les prix sont outrageusement chers même pour Rio : du 250 francs par personne, c’est presque Maxims ! Peu importe, c’est bon. Buffet froid (huitres, palourdes, saumon fumé), buffet chaud (spécialité bahianaise sans nom, paella, soupe aux poissons) et serveurs qui passent parmi les tables (langoustes, mais je suis déjà trop plein !). J’aurais du m’en douter : André, avec ses lunettes Armani et son portefeuille Pierre Cardin, a un je-ne-sais quoi de Nelly-esque qui me va bien, jusque dans le choix de ses restaurants. Et je ne suis pas encore allé deux fois dans le même avec lui.
A côté de nous, un brésilien raconte à une argentine, sa copine, l’histoire de l’indépendance du Brésil. André, en bon Portugais, fronce le sourcil : ce n’est pas comme ça qu’il voit les choses, lui ! J’apprends au passage que les Brésiliens détestent les Argentins, plus encore que les Portugais détestent les Espagnols.
Et me revoilà dans ma chambre, en me jurant de ne plus accepter un repas à Rio le premier soir : je suis plein et fatigué : là, le jet-lag est sans pitié.
Le lendemain
Rien de bien folichon : du boulot, notre personnel local s’améliore, et au dodo tôt après une salada caprese. Lorsque je ne mondanise pas avec la gentry portugaise d’Ipanema, j’ai découvert qu’une salade mangée dans la chambre est le meilleur des repas en déplacement. Vite pris, pas lourd, et pas trop cher, ce qui fait plaisir au patron (surtout après les folies d’hier où j’ai invité tout le monde). Salada caprese, donc, mais avec une caiprinha, on ne va quand même pas se laisser abattre. Un petit tour au business center pour lire mes mails perso et sévir sur le forum de Xavier Arnaud. Ce jour 18, Rome vient de réintégrer officiellement dans l’Eglise la fraction lefevriste de Campos, 28 000 fidèles, à 300 km d’ici, et un évêque schismatique. Le cardinal Castrillon Hoyos s’est déplacé, les évêques de Niteroi (de l’autre côté de la baie) et de Teresopolis aussi. Bien que pas directement et viscéralement lefévristes (l’évêque, Mgr Licinio Rangel, n’est pas un des quatre sacrés par Mgr Marcel en 88), leur cœur, et probablement aussi leurs lectures, leur formation, tout était de ce côté. C’est désormais fini, et l’on peut les considérer comme les premiers lefevristes à réintégrer l’Eglise. Deo Gratias, donc !
(NDS : et cerise sur le gâteau, Mgr Rifan Mgr Rifan, bras droit de Mgr Rangel , est consacré à Campos le 18 août 2002 par le Cardinal Castrillon Hoyos (cf photo), assisté de Mgr Rangel et d'un évêque brésilien : il s'agissait là du premier sacre épiscopal ,approuvé par Rome et célébré selon le Rite traditionnel ... depuis le Concile Vatican II)
Le lendemain, samedi : Petropolis.

Je retrouve à 10 heures Efraim Schweitzer, mon guide local, qui doit m’emmener visiter Petropolis avec quelques Paulistas. Les présentations sont simples : « Hello, this is Nelly. Nelly, this is Brazilian people”. Bonjour les Brésiliens ! En réalité une grand mère, une mère, une fille et un fils, tous de Sao Paulo, très classe, jusque chez les gamins. Les brésiliens riches ont de l’allure parfois ; et encore plus à Sao Paulo, qui passe pour la ville la plus européanisée du pays. En route donc dans un minibus VW, en compagnie de mes nouveaux amis du Boulevard Haussmann, pour Petropolis. Un crochet par Niteroi et le musée d’art moderne que je connais déjà, construit par Niemeyer. Arrêt à Duque de Caxias pour grignoter. On voit peu de campagne tant Rio est étendue. Le long de l’autoroute (qui va ensuite vers Belo Horizonte et le nord), ce ne sont que motels au nom évocateur. Motel Calèche. Motel California…
La route prend ensuite les montagnes. Les ingénieurs ont été astucieux, puisque la route qui dessert Petropolis est à sens unique : on peut doubler dans les lacets, c’est un vrai plaisir. Je comprends pourquoi Efraim m’a demandé de prendre un pull : nous montons à 400 mètres et – horresco referens – il se peut que la température baisse au-dessous de 20 degrés !
Petropolis est la cité construite autour de la résidence de dom Pedro II, empereur du Brésil au XIXeme siècle. 300 000 habitants tout de même, répandue dans un réseau de vallées verdoyantes (des palmiers dans la montagne !) et de canaux. Contrairement à Rio, la maison individuelle, souvent très coquette, y est reine.
Premier arrêt à la Quintadinha (de mémoire), un casino transformé en hotel puis en copropriété. Les salles sont immenses ; on dirait l’hôtel de Shining au pays des tropiques. Portes en arche gigantesques, moulures en stuc disproportionnées ; c’était là le plus grand hotel du Brésil. De dehors, on dirait l’Hermitage, à la Baule.
Visite du palais de dom Pedro. Nous sommes priés de chausser des patins. Reconstitution fidèle et brillante de la maison de l’empereur. Animal fétiche : le dragon. Armes : le globe avec une bande, et une croix. L’ensemble du palais est d’un goût sobre, exquis ; d’un luxe retenu (dom Pedro II n’était pas TRES riche, dirait-on), aéré, ensoleillé, bref, charmant.
Déjeuner dans un restaurant du coin, puis visite de le maison de Santos Dumont – qui est brésilien, on l’oublie trop souvent. Bizarre maison pour ce petit homme qui ressemble beaucoup à l’inspecteur Clouzeau, et faisait des marches dépareillées à ses escaliers pour obliger ses visiteurs à les commencer du pied droit ! Je peux voir dans la maison (roulement de tambour) la première douche chaude du Brésil ! Ben oui.
Cathédrale St Pierre d’Alcantara (cf photo). Petropolis est un siège épiscopal. Néo-gothique, imite le gothique rhénan du XV ème. Vitraux XIX ème de bon goût, ce que je fais remarquer à mon guide. « Evidemment, me répond-il, on n’exportait que les plus beaux ! »
Un arrêt dans un magasin de chocolat où mon guide touche certainement une commission, puis retour à Rio. Efraim essaye de m’entraîner pour le soir dans une répétition d’une école de samba, à Mangueira. C’est un quartier populaire, il y a une favela derrière, je ne sais pas trop si je dois. Efraim se redresse, digne : « monsieur, je suis un guide officiel, j’ai mon immatriculation au ministère, d’ailleurs voici ma carte (il habite à Copacabana, ça gagne bien, un guide !), croyez-vous que je vous emmènerais là si ce n’était pas sûr ? » Bon, d’accord.
Nous quittons Petropolis sur une note sinistre en passant près de l’endroit ou un glissement de terrain a emporté une partie d’une favela lors des pluies diluviennes d’il y a quelques semaines sur l’état de Rio et tué cinquante personnes. En voyant la petitesse de la partie de terre mise à nu, on ne peut s’empêcher de penser que cinquante personnes, c’est un tout petit glissement de terrain. A peine si on le remarque.
La route prend ensuite les montagnes. Les ingénieurs ont été astucieux, puisque la route qui dessert Petropolis est à sens unique : on peut doubler dans les lacets, c’est un vrai plaisir. Je comprends pourquoi Efraim m’a demandé de prendre un pull : nous montons à 400 mètres et – horresco referens – il se peut que la température baisse au-dessous de 20 degrés !
Petropolis est la cité construite autour de la résidence de dom Pedro II, empereur du Brésil au XIXeme siècle. 300 000 habitants tout de même, répandue dans un réseau de vallées verdoyantes (des palmiers dans la montagne !) et de canaux. Contrairement à Rio, la maison individuelle, souvent très coquette, y est reine.
Premier arrêt à la Quintadinha (de mémoire), un casino transformé en hotel puis en copropriété. Les salles sont immenses ; on dirait l’hôtel de Shining au pays des tropiques. Portes en arche gigantesques, moulures en stuc disproportionnées ; c’était là le plus grand hotel du Brésil. De dehors, on dirait l’Hermitage, à la Baule.
Visite du palais de dom Pedro. Nous sommes priés de chausser des patins. Reconstitution fidèle et brillante de la maison de l’empereur. Animal fétiche : le dragon. Armes : le globe avec une bande, et une croix. L’ensemble du palais est d’un goût sobre, exquis ; d’un luxe retenu (dom Pedro II n’était pas TRES riche, dirait-on), aéré, ensoleillé, bref, charmant.
Déjeuner dans un restaurant du coin, puis visite de le maison de Santos Dumont – qui est brésilien, on l’oublie trop souvent. Bizarre maison pour ce petit homme qui ressemble beaucoup à l’inspecteur Clouzeau, et faisait des marches dépareillées à ses escaliers pour obliger ses visiteurs à les commencer du pied droit ! Je peux voir dans la maison (roulement de tambour) la première douche chaude du Brésil ! Ben oui.
Cathédrale St Pierre d’Alcantara (cf photo). Petropolis est un siège épiscopal. Néo-gothique, imite le gothique rhénan du XV ème. Vitraux XIX ème de bon goût, ce que je fais remarquer à mon guide. « Evidemment, me répond-il, on n’exportait que les plus beaux ! »
Un arrêt dans un magasin de chocolat où mon guide touche certainement une commission, puis retour à Rio. Efraim essaye de m’entraîner pour le soir dans une répétition d’une école de samba, à Mangueira. C’est un quartier populaire, il y a une favela derrière, je ne sais pas trop si je dois. Efraim se redresse, digne : « monsieur, je suis un guide officiel, j’ai mon immatriculation au ministère, d’ailleurs voici ma carte (il habite à Copacabana, ça gagne bien, un guide !), croyez-vous que je vous emmènerais là si ce n’était pas sûr ? » Bon, d’accord.
Nous quittons Petropolis sur une note sinistre en passant près de l’endroit ou un glissement de terrain a emporté une partie d’une favela lors des pluies diluviennes d’il y a quelques semaines sur l’état de Rio et tué cinquante personnes. En voyant la petitesse de la partie de terre mise à nu, on ne peut s’empêcher de penser que cinquante personnes, c’est un tout petit glissement de terrain. A peine si on le remarque.
Le soir : Nelly danse la samba.
Me revoilà deux heures plus tard, après une pause-sushi, dans le minibus en route pour Mangueira, avec une américaine de Phoenix, un canado-suisse à l’air de trafiquant de drogue, trois allemandes et trois brésiliens du Sud. Nous sommes très en avance pour réserver une table. Caiprinhas toute, il y a déjà un orchestre qui joue. La salle est une sorte de hangar moyen, avec une galerie tout autour, et des tribunes. Tout est peint en rose et vert. Il y a une « palanque dos compositores » où prennent place quelques chanteurs et un guitariste (en rose et vert), et une grande tribune où s’installent vingt percussionnistes sous la direction de « Mestre Rosso » qui a son nom peint sur sa tribune à lui (en rose et vert). Tous ces musiciens en hauteur sont dirigés par un autre chef au sol. Presque tous sont noirs, et certains très vieux ; ce n’est pas sans rappeler les papys cubains popularisés par Wim Wenders il y a quelques années. Les chanteurs chantent déjà bien fort. Mais lorsque les vingt percussionnistes s’y mettent, c’est le délire ! Un vacarme assourdissant, qui n’a rien à envier à ceux des concerts rock, et mille personnes qui se mettent instantanément à se trémousser ensemble. C’est impressionnant ! Les paroles, humoristiques, parlent de « Brazil com z » et de « Brasil com s » et je les devine anti-américaines. Notre arizonienne, qui cause portugais, semble s’en amuser beaucoup.
Au mur, une banderole remercie le « mestre » précédent pour « sa magnifique interprétation de la samba » au carnaval dernier. (Note de 2003 : Mangueira est régulièrement première au défilé « officiel » du carnaval) Tout autour de la salle, des gars du service d’ordre sont juchés sur des escabeaux où l’on lit « ordem et disciplina », ce qui fait toujours sourire quand on sait la conception toute particulière que se fait le Brésil de ces deux qualités ! Ceci dit, la population est mélangée ; il y a des gens des favelas (on les devine plus qu’on ne les reconnaît : la plupart des habitants des favelas n’ont pas d’air spécial), des gens du peuple, et même des gens aisés. Tout cela prend du bon temps sans arrière-pensée, sans murmure social. C’est donc mon Arizonienne qui s’en émeut. D’abord, elle a l’impression de ne pas être dans l’action (nous sommes en effet à une table de touristes, en périphérie), et elle plaint tout ces pauvres gens qui n’ont pas le niveau d’éducation que nous avons. Oh dear ! Apparemment, « ces pauvres gens » s’en foutent bien. J’apprendrai par la suite que les écoles de samba, en plus d’être, non pas des écoles de danse, mais les corporations officielles qui défilent lors du carnaval officiel, développent à côté tout un programme éducatif, social, sportif ; une sorte de patronnage laïc qui tortille du bas, si j’ose dire. Et ne nous voilons pas la face, les visiteurs du « centre culturel de Mangueira » ce soir là s’amusaient beaucoup plus que les touristes venus les voir. J’avais déjà dit que les cariocas étaient beaux, en plus ils dansent bien. Il y a de quoi rendre jalouse une Américaine !
A une heure trois quart, je craque sous le bruit et demande à Efraim de me mettre dans un taxi (le van est allé reconduire les brésiliens du sud, super-gavés). Dehors l’ambiance est moins amicale. Efraim use de son badge pour couper une file de trente personnes et mettre monsieur le touriste qui a des dollars dans un taxi qui me ramène plus mort que vif à Ipanema.
Dimanche
Le calvaire ne fait que commencer. A dix heures, je me réveille avec un drôle de truc à l’estomac, une envie de vomir. Argh, cela ressemble bien à une petite gastro-entérite ! Me voilà parti pour une journée de diète, cloué devant la télé. Heureusement, ils en ont 80 chaines et je ne m’ennuie pas trop. Mon estomac ne se décide pas et me fait mal. Est-ce les sushis ? Le chocolat ? L’avis de Philippe, le lendemain, incriminera les glaçons. Mais comment boire une caipirinha sans glaçons ??? Je pense en fait avoir été victime indirecte d’une épidémie de gastro-entérite qui sévit à Rio, et qui a profité de l’état de fatigue extrême de samedi soir pour tenter d’attaquer.
Je regarde donc successivement 1°) Fargo (sous titré en portugais), 2°) Le Prince et le Pauvre, 3°) Thalassa sur les Galapagos, 4°) Temptation Island, 5°) un magazine belge pour jeunes qui parle de la pédophilie, 6°) André le Magnifique (sous titré en portugais !) 7°) Faut pas rêver. 8° Les quinze journaux quotidiens de TV5, y compris les québécois. Pauvre de moi.
Lundi.
Je reste au lit le matin, et me pointe chez S*** l’après-midi juste à temps pour assister à la coupure de courant qui va plonger dix états sur 27 dans le noir pendant trois heures. Autant dire que je ne travaille guère. Le soir, dîner au Bazzar, sur la Lagune, avec André, V***, et deux amis portugais, P*** et C***. Nous causons travail, consulting, wap et philosophie. La table aime Nietzsche et n’aime pas Descartes (bref : il est possible d’avoir une vie à 10 000 kilomètres de Paris). Mille-feuilles d’aubergine, chèvre et tomate confite ; saumon en croûte, et rien d’autre, je ne sais pas si mon estomac aurait supporté un dessert.
Mardi
Une vraie journée de travail, puis de souvenirs. J’écris cela au top floor de l’Ipanema Plaza, avant de partir pour l’aéroport. Devant moi, la vue du large. Autour, de l’air climatisé (il fait entre 30 et 35 dehors à l’ombre). Et dans ma panse, un excellent jus d’orange. Que demande le peuple ?
Je me suis fait upgrader en first pour le retour. J’espère que ça m’aidera à dormir. En route pour l’indigestion au caviar.
Au mur, une banderole remercie le « mestre » précédent pour « sa magnifique interprétation de la samba » au carnaval dernier. (Note de 2003 : Mangueira est régulièrement première au défilé « officiel » du carnaval) Tout autour de la salle, des gars du service d’ordre sont juchés sur des escabeaux où l’on lit « ordem et disciplina », ce qui fait toujours sourire quand on sait la conception toute particulière que se fait le Brésil de ces deux qualités ! Ceci dit, la population est mélangée ; il y a des gens des favelas (on les devine plus qu’on ne les reconnaît : la plupart des habitants des favelas n’ont pas d’air spécial), des gens du peuple, et même des gens aisés. Tout cela prend du bon temps sans arrière-pensée, sans murmure social. C’est donc mon Arizonienne qui s’en émeut. D’abord, elle a l’impression de ne pas être dans l’action (nous sommes en effet à une table de touristes, en périphérie), et elle plaint tout ces pauvres gens qui n’ont pas le niveau d’éducation que nous avons. Oh dear ! Apparemment, « ces pauvres gens » s’en foutent bien. J’apprendrai par la suite que les écoles de samba, en plus d’être, non pas des écoles de danse, mais les corporations officielles qui défilent lors du carnaval officiel, développent à côté tout un programme éducatif, social, sportif ; une sorte de patronnage laïc qui tortille du bas, si j’ose dire. Et ne nous voilons pas la face, les visiteurs du « centre culturel de Mangueira » ce soir là s’amusaient beaucoup plus que les touristes venus les voir. J’avais déjà dit que les cariocas étaient beaux, en plus ils dansent bien. Il y a de quoi rendre jalouse une Américaine !
A une heure trois quart, je craque sous le bruit et demande à Efraim de me mettre dans un taxi (le van est allé reconduire les brésiliens du sud, super-gavés). Dehors l’ambiance est moins amicale. Efraim use de son badge pour couper une file de trente personnes et mettre monsieur le touriste qui a des dollars dans un taxi qui me ramène plus mort que vif à Ipanema.
Dimanche
Le calvaire ne fait que commencer. A dix heures, je me réveille avec un drôle de truc à l’estomac, une envie de vomir. Argh, cela ressemble bien à une petite gastro-entérite ! Me voilà parti pour une journée de diète, cloué devant la télé. Heureusement, ils en ont 80 chaines et je ne m’ennuie pas trop. Mon estomac ne se décide pas et me fait mal. Est-ce les sushis ? Le chocolat ? L’avis de Philippe, le lendemain, incriminera les glaçons. Mais comment boire une caipirinha sans glaçons ??? Je pense en fait avoir été victime indirecte d’une épidémie de gastro-entérite qui sévit à Rio, et qui a profité de l’état de fatigue extrême de samedi soir pour tenter d’attaquer.
Je regarde donc successivement 1°) Fargo (sous titré en portugais), 2°) Le Prince et le Pauvre, 3°) Thalassa sur les Galapagos, 4°) Temptation Island, 5°) un magazine belge pour jeunes qui parle de la pédophilie, 6°) André le Magnifique (sous titré en portugais !) 7°) Faut pas rêver. 8° Les quinze journaux quotidiens de TV5, y compris les québécois. Pauvre de moi.
Lundi.
Je reste au lit le matin, et me pointe chez S*** l’après-midi juste à temps pour assister à la coupure de courant qui va plonger dix états sur 27 dans le noir pendant trois heures. Autant dire que je ne travaille guère. Le soir, dîner au Bazzar, sur la Lagune, avec André, V***, et deux amis portugais, P*** et C***. Nous causons travail, consulting, wap et philosophie. La table aime Nietzsche et n’aime pas Descartes (bref : il est possible d’avoir une vie à 10 000 kilomètres de Paris). Mille-feuilles d’aubergine, chèvre et tomate confite ; saumon en croûte, et rien d’autre, je ne sais pas si mon estomac aurait supporté un dessert.
Mardi
Une vraie journée de travail, puis de souvenirs. J’écris cela au top floor de l’Ipanema Plaza, avant de partir pour l’aéroport. Devant moi, la vue du large. Autour, de l’air climatisé (il fait entre 30 et 35 dehors à l’ombre). Et dans ma panse, un excellent jus d’orange. Que demande le peuple ?
Je me suis fait upgrader en first pour le retour. J’espère que ça m’aidera à dormir. En route pour l’indigestion au caviar.
Avion : Nelly s’empiffre en première classe, ou : l’esprit de pauvreté foulé aux pieds.
De retour de l’expérience ultime en first. Pour être ultime, cela l’a été. Je ne peux mentionner tous les détails qui font vous sentir une demi-divinité des cieux. Certes, je savais déjà, pour le pyjama et les pantoufles – on y prend très vite goût. La trousse de toilette est aussi bien plus fournie. En plus des bouchons pour oreilles, peigne, brosse à dents, chausse-pieds, on trouve une petite serviette, du lait démaquillant, deux ou trois échantillons Biotherm, un flacon d’Eau de Rochas, etc.
Côté menu, c’est à peu près comme en business (pas de caviar, donc, c’est juste pour le Concorde). En revanche, la carte des vins dépasse ce que l’on boit à la Casa Achlaw à Noël. Champagne Krug. Sauternes château Rieussec 94. Chassagne-Montrachet. Nuit St Georges (tout cela grand cru), et un St Julien également grand cru. J’ai donc pris du Sauternes en apéritif, du Chassagne-Montrachet (très bon) ave l’entrée et du Nuit St Georges avec le plat. (Je me suis arrêté après).
Pour le dodo, la couchette se met à l’horizontale, ce qui est bien pratique pour dormir vraiment… s’il n’y avait eu des turbulences incessantes, quasiment de Rio à Paris.
Côté menu, c’est à peu près comme en business (pas de caviar, donc, c’est juste pour le Concorde). En revanche, la carte des vins dépasse ce que l’on boit à la Casa Achlaw à Noël. Champagne Krug. Sauternes château Rieussec 94. Chassagne-Montrachet. Nuit St Georges (tout cela grand cru), et un St Julien également grand cru. J’ai donc pris du Sauternes en apéritif, du Chassagne-Montrachet (très bon) ave l’entrée et du Nuit St Georges avec le plat. (Je me suis arrêté après).
Pour le dodo, la couchette se met à l’horizontale, ce qui est bien pratique pour dormir vraiment… s’il n’y avait eu des turbulences incessantes, quasiment de Rio à Paris.
Cinéma plaqué or : A.I., de Steven Spielberg
Film du retour : Steven Spielberg, A.I. En voilà un drôle de film. Des parents – dont l’enfant est comateux, achètent le tout dernier robot de cyberdyne systems (ou presque) : une réplique d’enfant parfait, capable d’amour. La question se pose, grosse comme une montagne : même si c’est un robot, quelles sont les obligations des humains vis à vis de lui ? Malheureusement, à partir de là, tout part en couille de la plus lamentable des façons. Car notre Pinocchio moderne semble bien avoir ce qui ressemble à une conscience ; se rend compte qu’il n’est pas un garçon comme les autres, et cherche la « fée bleue » qui pourra faire de lui un vrai garçon (on craint le pire un moment sur la façon dont la fée pourrait s’y prendre).
Dans tout cela, le vrai fils du couple sort du coma, devient odieux avec le fils robot, etc. Mais Spielberg est assez rusé pour nous faire aimer inconditionnellement le robot, et un peu moins l’autre. Il est vrai que la frimousse de Haley Joel Osment convient à merveille à l’opération, et que non seulement il incarne de façon convaincante le type du « garçon parfait », mais il nous convainc qu’un gamin parfait, c’est quand même bien mieux qu’un gamin réel. H.J.O. est redoutablement attachant, et c’est cela qui sauve le reste du film du naufrage. Car en effet les malheurs vont s’accumuler sur son candide lui, lui tirant des mimiques absolument ravissantes. Si ce n’est pas du sadisme… D’abord, ses parents l’abandonnent ; ensuite il tombe entre les mains de gros péquenots qui n’aiment pas les robots, et puis il cherche la fée bleue sans la trouver ; puis semble la trouver au fond de la mer, dans un parc d’attractions de Long Island. J’avais oublié de vous dire que le niveau de la mer avait monté entre temps. Et le voilà donc – enfin – devant sa fée bleue, à lui dire « make a real boy from me, pleeaaaaaaase », ceci pendant deux mille ans. Sans rigoler, c’est une voix off qui le dit. Notre robot digne d’amour, plus fort que le lapin de Duracell, prend donc des mines suppliantes télégéniques durant deux mille ans. Après quoi, il y a une ère glaciaire qui arrive, le voilà pris sous la glace et sauvé par des, euh… martiens ? Enfin, des êtres génétiquement (beaucoup) modifiés, qui le sortent de là, et entendent qu’il n’a pas changé d’avis, et qu’il veut revoir sa môman. Mais voilà, depuis deux mille ans, la maman a du prendre un coup de vieux. Qu’à cela ne tienne, il a une boucle de cheveux d’elle, donc ils vont la refaire à partir de son ADN – parce qu’en deux mille ans, ils n’ont rien découvert de mieux. Seulement voilà, on peut recomposer quelqu’un, mais… car il y a un mais… on a découvert en fait que la somme des émotions de l’humanité était reflétée dans l’espace-temps (ils n’ont pas trouvé de nouvelle dimension depuis deux mille ans), que lorsqu’on recomposait quelqu’un, on utilisait un fil de cet espace-temps et qu’une fois qu’un chemin dans le continuum spatio-temporel était utilisé, eh bien on ne pouvait pas l’utiliser une seconde fois. Bref, « on peut recomposer ta maman, mais une fois qu’elle se sera endormie, le soir, elle disparaîtra à tout jamais. » Qu’à cela ne tienne, bring it on, répond le robot. Et la maman revient le jour suivant, et le fils robot s’efforce de ne pas lui faire comprendre toute la situation incongrue ; je crois bien qu’elle le considère comme son vrai fils, et envoyez le générique avec la grosse morale, il faut aller au bout de ses rêves… Spielberg, quoi.
Ce scénario, que Nelly aurait pu écrire sous acide, est paraît-il exactement celui que le regretté Stanley Kubrick aurait filmé s’il avait été vivant. Qu’il me soit permis d’en douter. Heureusement que l’on tombe sous le charme de H.J. Osment rapidement, et que l’on y reste, faute de quoi il n’y aurait pas grand chose à sauver de A.I., qui pousse la niaiserie très très au-delà des frontières posées par E.T. il y a bien longtemps déjà. Entre ça et la Menace Fantôme, on ne peut s’empêcher de penser que nos amuseurs fétiches des années 80 deviennent gâteux.
Dans tout cela, le vrai fils du couple sort du coma, devient odieux avec le fils robot, etc. Mais Spielberg est assez rusé pour nous faire aimer inconditionnellement le robot, et un peu moins l’autre. Il est vrai que la frimousse de Haley Joel Osment convient à merveille à l’opération, et que non seulement il incarne de façon convaincante le type du « garçon parfait », mais il nous convainc qu’un gamin parfait, c’est quand même bien mieux qu’un gamin réel. H.J.O. est redoutablement attachant, et c’est cela qui sauve le reste du film du naufrage. Car en effet les malheurs vont s’accumuler sur son candide lui, lui tirant des mimiques absolument ravissantes. Si ce n’est pas du sadisme… D’abord, ses parents l’abandonnent ; ensuite il tombe entre les mains de gros péquenots qui n’aiment pas les robots, et puis il cherche la fée bleue sans la trouver ; puis semble la trouver au fond de la mer, dans un parc d’attractions de Long Island. J’avais oublié de vous dire que le niveau de la mer avait monté entre temps. Et le voilà donc – enfin – devant sa fée bleue, à lui dire « make a real boy from me, pleeaaaaaaase », ceci pendant deux mille ans. Sans rigoler, c’est une voix off qui le dit. Notre robot digne d’amour, plus fort que le lapin de Duracell, prend donc des mines suppliantes télégéniques durant deux mille ans. Après quoi, il y a une ère glaciaire qui arrive, le voilà pris sous la glace et sauvé par des, euh… martiens ? Enfin, des êtres génétiquement (beaucoup) modifiés, qui le sortent de là, et entendent qu’il n’a pas changé d’avis, et qu’il veut revoir sa môman. Mais voilà, depuis deux mille ans, la maman a du prendre un coup de vieux. Qu’à cela ne tienne, il a une boucle de cheveux d’elle, donc ils vont la refaire à partir de son ADN – parce qu’en deux mille ans, ils n’ont rien découvert de mieux. Seulement voilà, on peut recomposer quelqu’un, mais… car il y a un mais… on a découvert en fait que la somme des émotions de l’humanité était reflétée dans l’espace-temps (ils n’ont pas trouvé de nouvelle dimension depuis deux mille ans), que lorsqu’on recomposait quelqu’un, on utilisait un fil de cet espace-temps et qu’une fois qu’un chemin dans le continuum spatio-temporel était utilisé, eh bien on ne pouvait pas l’utiliser une seconde fois. Bref, « on peut recomposer ta maman, mais une fois qu’elle se sera endormie, le soir, elle disparaîtra à tout jamais. » Qu’à cela ne tienne, bring it on, répond le robot. Et la maman revient le jour suivant, et le fils robot s’efforce de ne pas lui faire comprendre toute la situation incongrue ; je crois bien qu’elle le considère comme son vrai fils, et envoyez le générique avec la grosse morale, il faut aller au bout de ses rêves… Spielberg, quoi.
Ce scénario, que Nelly aurait pu écrire sous acide, est paraît-il exactement celui que le regretté Stanley Kubrick aurait filmé s’il avait été vivant. Qu’il me soit permis d’en douter. Heureusement que l’on tombe sous le charme de H.J. Osment rapidement, et que l’on y reste, faute de quoi il n’y aurait pas grand chose à sauver de A.I., qui pousse la niaiserie très très au-delà des frontières posées par E.T. il y a bien longtemps déjà. Entre ça et la Menace Fantôme, on ne peut s’empêcher de penser que nos amuseurs fétiches des années 80 deviennent gâteux.