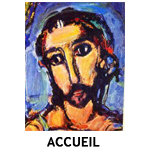Cinéma : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet.

Finalement, je crois que je me suis trompé, Jeunet est un bon cinéaste. Amélie est un film faussement naïf et quotidien. Jeunet arrive à évoquer des gestes que tout le monde connaît, qui parlent, donc (faire éclater les bulles des enveloppes à bulles), mais dans un monde qui, s’il a l’air ordinaire, est totalement parcouru par l’extravagance. Il y a beaucoup d’humour, et surtout un art consommé de la narration, cousin lointain de celui que Fincher développe dans Fight Club, concis, serré, qui fait qu’on ne s’ennuie pas une seconde en deux heures. Bref, Amélie est un très bon film, très distrayant, qui n’a pas volé ses millions de spectateurs. Je recommande d’aller le voir.
Cinéma : Almost Famous, de Cameron Crowe.
Almost Famous raconte l’histoire d’un adolescent qui se retrouve embarqué en 1973 dans la tournée d’un groupe de rock, pour écrire un article sur eux dans Rolling Stone. C’est un démontage nostalgique du rock’n roll circus, et des intérêts financiers qui se taillaient la part du lion à l’époque. Groupies, argent, pouvoir, la musique souffre bien dans tout cela, et c’est très probablement une vision fidèle de ce qui se passait alors. La mère de William, le héros principal, semble rétrograde et ridicule mais c’est elle une des seules qui a la tête bien faite ; Cameron Crowe nous laisse finalement voir, au-delà de la nostalgie qui a ravi les critiques de cinq à dix ans de plus que moi, que rien ne sauve le milieu. Artistes décérébrés et drogués, groupies qui s’échangent entre groupes pour 50$ et une caisse de bière, et se prennent pour les muses de ces messieurs alors qu’elles sont leurs putes. Managers avides ; les musiciens trop heureux de découvrir une vie de permissivité dans des palaces qu’ils n’auraient jamais pu approcher autrement ; conflits d’ego vulgaires, manœuvres souterraines des maisons de disques. Toute cette médiocrité est résumée dans la scène de l’avion, pris dans un orage, ou tout le monde déballe son regret secret avant de mourir : j’ai couché avec untel, j’ai couché avec tel autre, je ne t’aime pas – c’est au niveau des pâquerettes – et à un moment, l’un d’eux, qui n’avait rien dit, se lâche : « je suis homo ! » Deux secondes après, la tempête cesse, ils ne mourront pas… et l’autre aurait mieux fait de la fermer.
Autre partie amusante, l’insistance avec laquelle la mère de William (Frances Mc Dormand, qui jouait la flic plouque dans Fargo) le poursuit, y compris par télégramme, en criant « ne te drogue pas ! » aux abords d’une salle de concert. Comment foutre la honte à son fils. Don’t take drugs !
Un bon petit film, finalement. Spinal tap sans le côté satirique.
Autre partie amusante, l’insistance avec laquelle la mère de William (Frances Mc Dormand, qui jouait la flic plouque dans Fargo) le poursuit, y compris par télégramme, en criant « ne te drogue pas ! » aux abords d’une salle de concert. Comment foutre la honte à son fils. Don’t take drugs !
Un bon petit film, finalement. Spinal tap sans le côté satirique.
Cinéma : Le Parrain, de Francis Ford Coppola
Le Parrain ou : quelqu’un de si bien habillé et si a cheval sur l’honneur de la famille ne peut pas être totalement mauvais. Le Parrain, avec le recul, ressemble aux Soprano en 1946. C’est l’histoire de Michael Corleone (Al Pacino) qui rentre de la guerre, retrouve sa famille et son parrain (Marlon Brando). Mais voilà, une guerre des gangs s’ensuit, et Michael prend graduellement la responsabilité du clan, et, de héros de l’Amérique, devient à la fin du film un caïd encore plus impitoyable que son père. Il y a notamment une scène géniale où à peu près tous ses faux amis et ennemis sont assassinés de manière synchronisée pendant qu’il assiste au baptême de son filleul. Les meurtres sont intercalés entre les questions-réponses du credo et de la renonciation au mal ; c’est puissant.
Une autre chose puissante, c’est la sympathie que l’on éprouve pour les méchants ; Coppola arrive à faire passer toute une bande de mafieux pour les gentils de l’histoire. C’est assez fort !
Une autre chose puissante, c’est la sympathie que l’on éprouve pour les méchants ; Coppola arrive à faire passer toute une bande de mafieux pour les gentils de l’histoire. C’est assez fort !
Cinéma : Virgin Suicides, de Sofia Coppola
Puis, pour rester dans la famille Coppola, Virgin suicides de la fille, Sofia. C’est une première œuvre qui me semble très bonne – je suis resté scotché à la télé une heure trente de plus. Il y a beaucoup dans l’ambiance. L’histoire est en effet ténue : le prof de maths d’un bahut du Michigan a cinq filles, très semblables, toutes plus belles les unes que les autres, qu’il tient recluses dans une ambiance rigoriste. Un jour, l’une d’elles se suicide ; et une bande de garçons du même âge tente de comprendre ce qui se passe, ce que pensent les quatre autres, et essayent de les détourner de suivre le chemin de leur sœur. Cela semble être le combat de la chèvre de M. Seguin ; pendant tout le film, les garçons tentent de comprendre ces filles mystérieuses, et n’y arrivent pas le moins du monde. L’ambiance particulière, un peu nostalgique ; et la musique de Air rehausse cette histoire pour en faire un petit chef d’œuvre pas moralisateur ni macabre ; au contraire, fixé sur la beauté des sœurs et l’incompréhensibilité de leur geste. Un conte du passé, en quelque sorte. Recommandé
Tourisme : St Valentin à Prague, alcools dégénérés.
Nous aurons été cinq garçons (Petr K***, Jaroslav J***, Tomas, Vincent, Frédéric C***et moi) et Lucie dans une pizzeria branchée (« Kogo ») de Nove Mesto. Jan Z***, lui, est avec sa vraie copine, ailleurs.
Descente ensuite dans un caveau tout aussi trendy (Kosicka, si je retiens bien), avec des chèvres en fer-blanc accrochées au mur. Nous goûtons la spécialité locale, le B52. Baileys, absinthe (qui est légale ici), le tout enflammé dans des petits godets, que l’on aspire par une paille, en commençant par le fond. Un truc de djeunz destroy. A propos de destroy, Fréderic est le seul à fumer ; aucun des Tchèques (ni le Slovaque) ne fume. Voilà des peuples qui ont de l’avenir ! Dans un coin, Tomas parle avec feu de Milosevic ; hélas il en parle en Tchèque et je n’y comprends rien.
Une autre quart d’heure culturel, lorsque nous parlons des langues que l’on apprend ici au lycée. L’anglais, certes, l’allemand aussi, mais à égalité avec le russe. Un peu plus à l’ouest, cher professeur…
Trois B52, deux Beton (BE-cherovka and TON-ic) et une bière plus tard, mes collègues consentent à rentrer. Je ne suis même pas rond.
Descente ensuite dans un caveau tout aussi trendy (Kosicka, si je retiens bien), avec des chèvres en fer-blanc accrochées au mur. Nous goûtons la spécialité locale, le B52. Baileys, absinthe (qui est légale ici), le tout enflammé dans des petits godets, que l’on aspire par une paille, en commençant par le fond. Un truc de djeunz destroy. A propos de destroy, Fréderic est le seul à fumer ; aucun des Tchèques (ni le Slovaque) ne fume. Voilà des peuples qui ont de l’avenir ! Dans un coin, Tomas parle avec feu de Milosevic ; hélas il en parle en Tchèque et je n’y comprends rien.
Une autre quart d’heure culturel, lorsque nous parlons des langues que l’on apprend ici au lycée. L’anglais, certes, l’allemand aussi, mais à égalité avec le russe. Un peu plus à l’ouest, cher professeur…
Trois B52, deux Beton (BE-cherovka and TON-ic) et une bière plus tard, mes collègues consentent à rentrer. Je ne suis même pas rond.
Cinéma : Asterix et Cléopâtre, de Alain Chabat.
Ca commence mal, puisque les génériques m’annoncent qu’une partie de mon argent va aller aux deux gros AHEM notoires Dieudonné, et Claude Berri. Comme trop souvent dans le cinéma français, c’est filmé avec les pieds. Les travelings, les angles de vue, les effets musicaux semblent être tirés du catalogue et ne souligner en rien la narration. Depardieu et Clavier cachetonnent honteusement. On ne voit pas Obélix, on voit Depardieu avec les cheveux teints en roux et c’est tout.
Chabat en Jules César (qu’il prend plaisir à prononcer à l’anglaise) est assez bon ; Monica Bellucci tient bien son rôle de bombe ; et Djamel est presque très bon. Il y a, comme la critique l’a souligné, une invasion du film comique classique par la jeune génération. On se prend à penser que c’est tant mieux, tant les recettes et les acteurs (Depardieu et Clavier) sont vieux, usés, prévisibles et nuls. On dirait que rien n’a changé depuis la Grande Vadrouille ; et c’est un plaisir de voir des acteurs plus jeunes investir cette coquille vide avec des références un peu plus amusantes. Bien entendu, cela fait un film déséquilibré, mauvais mais avec les seconds rôles qui s’unissent pour tenter de le sauver.
Il y a donc un grand nombre de références pop (des personnages s’appellent Itinérix ou THix), et heureusement, un certain nombre de références franchement drôles. L’une d’elles toutefois, tombe à plat ; celle où Dieudonné, vu de dos, imite Dark Vador ; on avait remarqué son gros casque depuis quinze minutes (cf. la folle histoire de l’espace) et la surprise tombe à plat. « Quand on attaque l’empire, l’empire contre-attaque » : qu’est-ce que c’est que cette réplique de merde ?
Chabat en Jules César (qu’il prend plaisir à prononcer à l’anglaise) est assez bon ; Monica Bellucci tient bien son rôle de bombe ; et Djamel est presque très bon. Il y a, comme la critique l’a souligné, une invasion du film comique classique par la jeune génération. On se prend à penser que c’est tant mieux, tant les recettes et les acteurs (Depardieu et Clavier) sont vieux, usés, prévisibles et nuls. On dirait que rien n’a changé depuis la Grande Vadrouille ; et c’est un plaisir de voir des acteurs plus jeunes investir cette coquille vide avec des références un peu plus amusantes. Bien entendu, cela fait un film déséquilibré, mauvais mais avec les seconds rôles qui s’unissent pour tenter de le sauver.
Il y a donc un grand nombre de références pop (des personnages s’appellent Itinérix ou THix), et heureusement, un certain nombre de références franchement drôles. L’une d’elles toutefois, tombe à plat ; celle où Dieudonné, vu de dos, imite Dark Vador ; on avait remarqué son gros casque depuis quinze minutes (cf. la folle histoire de l’espace) et la surprise tombe à plat. « Quand on attaque l’empire, l’empire contre-attaque » : qu’est-ce que c’est que cette réplique de merde ?
Cinéma : 58 minutes pour vivre (aka Die Harder), de Renny Harlin (à défaut d’avoir John McTiernan)
Des méchants terroristes piratent la tour de contrôle de l’aéroport de Dulles (Washington DC), éteignent les pistes, pour faire évader un général sud-américain. Pendant ce temps, des tas d’avions tournent en l’air sans pouvoir se poser et commencent à manquer de fuel.
Bien sûr, Bruce Willis va nettoyer cela à lui seul face à des flics incapables et des soldats renégats. Cela n’aura pas la cohésion du premier Die Hard mais ça reste bon tout de même. Les scènes violentes sont bien dosées, mais l’argument dans son ensemble est plus faible : après tout, Willis n’est pas obligé de faire tout ce qu’il fait.
Deux passages spectaculaires, celui du crash d’un avion, et celui de l’explosion d’un 747. Le crash de l’avion est trop préparé, avec une hôtesse qui assure un passager qu’il ne ratera pas sa correspondance et qu’il sera bientôt chez lui. A partir de cela, on se doute que quelque chose va mal se passer.
Quant au 747, on voit Bruce Willis se battre avec le méchant sur son aile (alors qu’il roule !) et puis après, badaboum ! Ce sont des moments où on est bien content d’avoir un home-cinema – même si la télé n’est pas assez grande encore !
Bien sûr, Bruce Willis va nettoyer cela à lui seul face à des flics incapables et des soldats renégats. Cela n’aura pas la cohésion du premier Die Hard mais ça reste bon tout de même. Les scènes violentes sont bien dosées, mais l’argument dans son ensemble est plus faible : après tout, Willis n’est pas obligé de faire tout ce qu’il fait.
Deux passages spectaculaires, celui du crash d’un avion, et celui de l’explosion d’un 747. Le crash de l’avion est trop préparé, avec une hôtesse qui assure un passager qu’il ne ratera pas sa correspondance et qu’il sera bientôt chez lui. A partir de cela, on se doute que quelque chose va mal se passer.
Quant au 747, on voit Bruce Willis se battre avec le méchant sur son aile (alors qu’il roule !) et puis après, badaboum ! Ce sont des moments où on est bien content d’avoir un home-cinema – même si la télé n’est pas assez grande encore !
Cinéma : Ocean’s Eleven, de Steven Soderbergh.

Onze truands vont braquer la recette de trois casinos à Las Vegas. Cela dans une ambiance très Patrick Bateman, puisque les truands sont extrêmement bien habillés – Brad Pitt, en particulier, nous convaincrait presque que le costume croisé blanc cassé peut se porter en ville, sans ceinture. L’histoire est assez classique – c’est un peu la scène de la chambre forte de Mission Impossible étendue à la dimension d’un film – mais c’est excellemment filmé ; les plans, les couleurs, la composition des images, tout cela est fort léché. En bref, de la technique au service du divertissement ; n’est-ce pas cela, l’art ?
Le meilleur film de l’année ou presque : Black Hawk Down (le chute du faucon noir) de Ridley Scott.
Cela va être difficile d’être sans biais, vu que ce film exclusivement un film de guerre, avec soldats américains à gogo. Et que ces derniers, avec les mafiosi, sont mes genres de personnages préférés dans le cinéma yankee.
Le film souffre d’une schizophrénie : d’une part, une séquence d’ouverture relate la misère dans laquelle les somaliens se trouvent du fait d’Aidid (300 000 morts de faim), avec une musique qui fait penser à du Buddha Bar en pleine déprime. Ensuite, un peu de civilisation : portrait de quelques rangers, le jeune bleu qui veut en casser un max – c’est ainsi que l’on a traduit « I want to kick ass » - et le sergent-qui-veut-découvrir la civilisation de l’ennemi, Josh Hartnett, qui abuse d’une technique de froncement de sourcils très élaborée. Il va faire de l’ombre à Brad Pitt s’il continue.
Et puis après, deux heures sans arrêt où ça pète dans tous les coins, et où le film se transforme en une séance de Half Life (américains : 19, somaliens : 1000). Les pauvres somaliens se font massacrer comme les germains dans la scène d’ouverture de Gladiator, la technologie en plus. Et du souci humanitaire, respect-des-cultures, qui pointait en début de film, il ne reste vite plus rien – tant mieux – qu’une démonstration de la supériorité écrasante de l’armée américaine ; ainsi que la liste des points communs qu’il y a entre une opération sur le terrain et la gestion d’un projet informatique.
Dix neuf morts américains et des hectolitres d’hémoglobine plus tard, avec notamment une opération de l’artère fémorale franchement gore, plus personne ne doute que la guerre est un peu absurde, que les américains sont la meilleure armée du monde, et que leurs soldats sont plus beaux que la moyenne. Ridley Scott a réussi à faire un film avec deux heures de combat non-stop ; c’est même prenant. En sortant du cinéma, on se prête à imaginer que les héros existent (signe du bon film, en général), on a même envie de canarder quelques somaliens qui traineraient par là. Mais, question cruciale, vais-je acheter le DVD ? Autrement dit, est-ce que le film supporte une seconde vision ? Je n’en suis pas sûr.
Le film souffre d’une schizophrénie : d’une part, une séquence d’ouverture relate la misère dans laquelle les somaliens se trouvent du fait d’Aidid (300 000 morts de faim), avec une musique qui fait penser à du Buddha Bar en pleine déprime. Ensuite, un peu de civilisation : portrait de quelques rangers, le jeune bleu qui veut en casser un max – c’est ainsi que l’on a traduit « I want to kick ass » - et le sergent-qui-veut-découvrir la civilisation de l’ennemi, Josh Hartnett, qui abuse d’une technique de froncement de sourcils très élaborée. Il va faire de l’ombre à Brad Pitt s’il continue.
Et puis après, deux heures sans arrêt où ça pète dans tous les coins, et où le film se transforme en une séance de Half Life (américains : 19, somaliens : 1000). Les pauvres somaliens se font massacrer comme les germains dans la scène d’ouverture de Gladiator, la technologie en plus. Et du souci humanitaire, respect-des-cultures, qui pointait en début de film, il ne reste vite plus rien – tant mieux – qu’une démonstration de la supériorité écrasante de l’armée américaine ; ainsi que la liste des points communs qu’il y a entre une opération sur le terrain et la gestion d’un projet informatique.
Dix neuf morts américains et des hectolitres d’hémoglobine plus tard, avec notamment une opération de l’artère fémorale franchement gore, plus personne ne doute que la guerre est un peu absurde, que les américains sont la meilleure armée du monde, et que leurs soldats sont plus beaux que la moyenne. Ridley Scott a réussi à faire un film avec deux heures de combat non-stop ; c’est même prenant. En sortant du cinéma, on se prête à imaginer que les héros existent (signe du bon film, en général), on a même envie de canarder quelques somaliens qui traineraient par là. Mais, question cruciale, vais-je acheter le DVD ? Autrement dit, est-ce que le film supporte une seconde vision ? Je n’en suis pas sûr.
Tourisme : au pays du Signe de Piste

Départ pépère le matin pour le Pays Perdu. En voiture et par une très belle journée, ce qui rappelle en moi de bien agréables souvenirs de courses similaires il y a quelques années. L’avion, c’est bien, le TGV, c’est pas mal, mais se promener en France en voiture, ce n’est pas mal du tout, non plus. Mes roues me portent donc à Noyers-sur-Serein qui est « l’un des plus beaux villages de France », tout comme Pesmes, d’ailleurs. Pour ceux qui ne sauraient pas, et ils sont nombreux, Noyers est dans le pays de Tonerre.
Puis direction Montbard et l’abbaye de Fontenay (ci-contre) que j’ai grand plaisir à revoir malgré une arriération volontaire du lieu : pas de règlement par carte de crédit, pas de timbres vendus, et pas de boîte aux lettres. Pour un truc classé au patrimoine de l’Unesco, c’est fruste. Heureusement, une fois la porte franchie, la beauté et l’unité du lieu sont intactes. La beauté est une chose qui aide beaucoup dans la vie religieuse, et j’ai du mal à comprendre comment les « Franciscains du Bronx », la coqueluche actuelle des cathos BCBG, arrivent à tenir le coup.
La fois d’avant, c’était en 1996, si ma mémoire est bonne, avec le groupe du P. Bernard ***. Il devait y avoir (peu importe, Nd2003). Il y avait également un ancien scout de chez *** qui s’appelait Alexandre ***, que je n’ai plus croisé depuis, et qui était un prodige de serviabilité et de bonne éducation. Le voyage avait commencé sinistrement à Clairvaux puis s’était amélioré avant de finir en beauté à Fontenay et de faire une escale à Ars avant de rentrer. Et, oui, nous étions passés à Acey sur le chemin pour admirer l’offertoire-petit-déjeuner, le P. Sous-Prieur et ses anecdotes, et, pour ceux qui savaient, l’abbaye décrite dans le Relais de la Chance au Roy. Mais bien peu savaient, je crois. Pour ceux qui savaient, aussi, Acey avait été une fille de Solesmes durant quelques années ; Dom Guéranger, pour des raisons administratives ou fiscales, voire politiques, avait mis la propriété au nom du supérieur du moment… et le supérieur, qui n’avait pas encore digéré son vœu de pauvreté parfaitement, s’en était ensuite prétendu le propriétaire, avait géré la fondation à sa guise, s’était rebellé, en avait appelé à l’évêque de St Claude. N’était tout cela, nous aurions pu avoir des bénédictins de bonne race là-dedans.
Après Fontenay, je mets le cap sur Dijon puis Pesmes. A*** est arrivé une heure avant moi et est allé faire le « tour du propriétaire ». Nous nous retrouvons bien vite et allons dîner. Je refais connaissance avec la cuisine Vieille, dont on peut tout dire sauf qu’elle est parcimonieuse. Brochet froid à la mayonnaise, saumon chaud, plateau de fromages imposant avec ma cancoillote bien aimée, et un Colonel pour finir. Durée de l’épreuve : trois heures. Après quoi nous déambulons par des rues mal éclairées jusqu’à l’église, puis au dodo.
Samedi, tourisme dans le Jura. Direction Champagnole pour la route des Sapins. C’est une route-concept que j’avais fréquenté en 95 : cinquante kilomètres de route forestière sous les sapins de la Joux puis de la forêt de Levier. La signalisation a été refaite depuis et nous nous égarons plusieurs fois. Pas assez toutefois pour omettre de saluer le sapin président de la Joux.
Une fois à Levier, nous obliquons vers la source du Lison, avec un passage au « pont du diable ». Puis Nans-sous-Ste-Anne, qui inspira Louis Pergaud pour sa Guerre de boutons. Je décide, bien qu’affamé, que l’on n’y mangera rien de bon et nous partons pour Salins où nous avons le plaisir de tomber sur ce qui est sans doute le meilleur restaurant de la ville. Si je me souviens bien, cela s’appelle le restaurant des bains. Vol-au-vent aux morilles en entrée (très bon, et les morilles cueillies dans la forêt du coin, pas à Rungis), puis un plat très bon également mais dont je ne me souviens plus. En vin, un Arbois Pupillin savagnin de très bonne tenue. Ce petit balthazar au milieu de, euh, pas grand chose, est une des surprises que l’on aime recevoir.
Nous nous rendons ensuite à la saline d’Arc et Senans que je visite pour la première fois. Musée avec des maquettes de Ledoux, et autres trucs sur l’urbanisme. Un *** *** y sentirait la maçonnerie à dix pas ; mais lorsque la maçonnerie se mêle à tant d’imagination… Un regret : on n’y cause pas de Niemeyer.
Retour à travers la forêt de Chaux par la route de la septième colonne, puis par Gendrey. Le soir, nous entendons les vêpres à Acey.
Dimanche, journée bisontine. J’emmène A*** à la fraternité St Pierre ; la messe se tient toujours aussi bien. L’introit et la communion sont chantés en grégorien, le trait en faux-bourdon. Déjeuner au gril de trappeur cher à Emmanuelle ***. On dirait que la Nelly s’est refait un dimanche de l’été 95. Puis déambulation dans Besac’ où nous croisons le carnaval local. En plein carême ! Nous arrivons tout de même à visiter la cathédrale. Pas le temps de visiter la citadelle, retour à la voiture, puis à Pesmes. L’hôtelier nous avait fait cadeau le matin même d’une bouteille de vin chacun en réparation d’une panne d’eau chaude.
Retour à Paris sans encombre.
Puis direction Montbard et l’abbaye de Fontenay (ci-contre) que j’ai grand plaisir à revoir malgré une arriération volontaire du lieu : pas de règlement par carte de crédit, pas de timbres vendus, et pas de boîte aux lettres. Pour un truc classé au patrimoine de l’Unesco, c’est fruste. Heureusement, une fois la porte franchie, la beauté et l’unité du lieu sont intactes. La beauté est une chose qui aide beaucoup dans la vie religieuse, et j’ai du mal à comprendre comment les « Franciscains du Bronx », la coqueluche actuelle des cathos BCBG, arrivent à tenir le coup.
La fois d’avant, c’était en 1996, si ma mémoire est bonne, avec le groupe du P. Bernard ***. Il devait y avoir (peu importe, Nd2003). Il y avait également un ancien scout de chez *** qui s’appelait Alexandre ***, que je n’ai plus croisé depuis, et qui était un prodige de serviabilité et de bonne éducation. Le voyage avait commencé sinistrement à Clairvaux puis s’était amélioré avant de finir en beauté à Fontenay et de faire une escale à Ars avant de rentrer. Et, oui, nous étions passés à Acey sur le chemin pour admirer l’offertoire-petit-déjeuner, le P. Sous-Prieur et ses anecdotes, et, pour ceux qui savaient, l’abbaye décrite dans le Relais de la Chance au Roy. Mais bien peu savaient, je crois. Pour ceux qui savaient, aussi, Acey avait été une fille de Solesmes durant quelques années ; Dom Guéranger, pour des raisons administratives ou fiscales, voire politiques, avait mis la propriété au nom du supérieur du moment… et le supérieur, qui n’avait pas encore digéré son vœu de pauvreté parfaitement, s’en était ensuite prétendu le propriétaire, avait géré la fondation à sa guise, s’était rebellé, en avait appelé à l’évêque de St Claude. N’était tout cela, nous aurions pu avoir des bénédictins de bonne race là-dedans.
Après Fontenay, je mets le cap sur Dijon puis Pesmes. A*** est arrivé une heure avant moi et est allé faire le « tour du propriétaire ». Nous nous retrouvons bien vite et allons dîner. Je refais connaissance avec la cuisine Vieille, dont on peut tout dire sauf qu’elle est parcimonieuse. Brochet froid à la mayonnaise, saumon chaud, plateau de fromages imposant avec ma cancoillote bien aimée, et un Colonel pour finir. Durée de l’épreuve : trois heures. Après quoi nous déambulons par des rues mal éclairées jusqu’à l’église, puis au dodo.
Samedi, tourisme dans le Jura. Direction Champagnole pour la route des Sapins. C’est une route-concept que j’avais fréquenté en 95 : cinquante kilomètres de route forestière sous les sapins de la Joux puis de la forêt de Levier. La signalisation a été refaite depuis et nous nous égarons plusieurs fois. Pas assez toutefois pour omettre de saluer le sapin président de la Joux.
Une fois à Levier, nous obliquons vers la source du Lison, avec un passage au « pont du diable ». Puis Nans-sous-Ste-Anne, qui inspira Louis Pergaud pour sa Guerre de boutons. Je décide, bien qu’affamé, que l’on n’y mangera rien de bon et nous partons pour Salins où nous avons le plaisir de tomber sur ce qui est sans doute le meilleur restaurant de la ville. Si je me souviens bien, cela s’appelle le restaurant des bains. Vol-au-vent aux morilles en entrée (très bon, et les morilles cueillies dans la forêt du coin, pas à Rungis), puis un plat très bon également mais dont je ne me souviens plus. En vin, un Arbois Pupillin savagnin de très bonne tenue. Ce petit balthazar au milieu de, euh, pas grand chose, est une des surprises que l’on aime recevoir.
Nous nous rendons ensuite à la saline d’Arc et Senans que je visite pour la première fois. Musée avec des maquettes de Ledoux, et autres trucs sur l’urbanisme. Un *** *** y sentirait la maçonnerie à dix pas ; mais lorsque la maçonnerie se mêle à tant d’imagination… Un regret : on n’y cause pas de Niemeyer.
Retour à travers la forêt de Chaux par la route de la septième colonne, puis par Gendrey. Le soir, nous entendons les vêpres à Acey.
Dimanche, journée bisontine. J’emmène A*** à la fraternité St Pierre ; la messe se tient toujours aussi bien. L’introit et la communion sont chantés en grégorien, le trait en faux-bourdon. Déjeuner au gril de trappeur cher à Emmanuelle ***. On dirait que la Nelly s’est refait un dimanche de l’été 95. Puis déambulation dans Besac’ où nous croisons le carnaval local. En plein carême ! Nous arrivons tout de même à visiter la cathédrale. Pas le temps de visiter la citadelle, retour à la voiture, puis à Pesmes. L’hôtelier nous avait fait cadeau le matin même d’une bouteille de vin chacun en réparation d’une panne d’eau chaude.
Retour à Paris sans encombre.