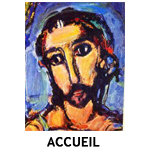Cinéma : Le pacte des loups, de Christophe Gans
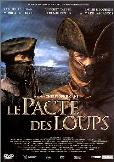
Le narrateur du film, âgé, sur fond de révolution grondante, nous annonce que les certitudes transforment souvent les hommes en bêtes. Nous voilà prévenus : la bébête qu’on va nous montrer est moins coupable que les hommes. Et, en matière d’hommes dégénérés, nous allons être servis. Pour tout dire, le pacte des loups est un film anti-grenoblois. (Non, je ne confonds pas Gévaudan et Grésivaudan !)
L’histoire : Grégoire de Fronsac (et pourquoi pas de Pommerol ?), naturaliste, bel esprit sans excès, arrive de Paris à Mende pour naturaliser la bête qui sème la terreur une fois qu’on l’aura prise. Il arrive avec un indien qu’il a ramené de ses expéditions en Nouvelle France. Il loge au château d’Apcher. Le terrain des exactions de la bête est d’ailleurs assez familier à votre diariste, puisqu’on est en pleine Margeride. On cause donc du mont Mouchet à tire-larigot ; Apcher vient sans doute de St Chély du même nom, etc. Mende est un peu loin de tout cela.
Enfin bref, le naturaliste est présenté à la société du coin, une dizaine de notables complexés par tout ce qui vient de Paris. Ces notables m’ont rappelé bien des personnes : ils forment une coterie, « on est bien entre nous », fermée aux étrangers. Ils font pour la plupart figure d’être pieux mais n’ont rien à cirer de la messe. Leur esprit est d’une étroitesse caractéristique. Bien entendu, la présence de l’indien permet un couplet discret sur le respect de l’autre ; un couplet plus lourd sur « ont-ils une âme ? » (- Si, si, on en a même accouplé avec des blancs, ils font des enfants, ce sont bien des humains. – Pf ! Cela ne veut rien dire !) L’indien a un double rôle : manifester la bassesse des notables, et voir l’invisible. Classique.
La bébête, pendant ce temps, se voit de plus en plus. C’est comme une espèce de porc-épic géant croisé avec un dinosaure pataud, et qui serait de très mauvaise humeur parce qu’on lui a fait renifler du poivre. L’auteur se paye même quelques scènes se rapportant directement à Alien. Donc la bête tue, et tue sans arrêt. Pendant ce temps, les culs-terreux du coin, qui ressemblent plus à des hommes de Genghis Khan qu’à d’honnêtes Auvergnats, se bastonnent avec Mani, l’indien. (Non, son patronyme n’est pas Kéen.)
Après un bout de temps, le roi, menacé politiquement par cette affaire, envoie un de ses soldats pour capturer la bête. Ce dernier revient avec un loup, que Fronsac, par ordre, falsifie pour en faire un gros méchant loup, et poum, l’affaire est enterrée, et Fronsac envoyé en Afrique pour qu’il ne cause pas trop.
Mais il revient clandestinement en Gévaudan parce qu’il est persuadé que la bête n’est pas un loup. Là, il découvre la vérité : c’est une créature dans une cuirasse, dirigée par l’abbé du coin, que la lecture de l’Apocalypse a un peu perturbé. L’abbé s’est monté une sorte de Sodalitium pianum à lui seul pour punir Louis XV de ne pas être assez sévère avec les philosophes. Son plan est de répandre plein de bêtes sur tout le pays, comme preuve de l’apocalypse qui commence, parce que le très-chrétien Louis XV ne l’a pas été assez. Les notables du coin en font tous partie, de même qu’une bonne poignée de paysans : c’est vraiment la conjuration de tradiland-sur-Province. Mani se fait tuer dans l’histoire, et Fronsac, peinturluré en indien, revient le venger et en zigouille un grand nombre avant d’être pris à son tour et, euh… je ne me souviens plus de la fin.
Bref, c’est Angélique meets Matrix meets Alien meets Mad Max meets Sergio Leone meets Tim Burton meets John Woo. Un sacré fourre-tout encore plus invraisemblable que les Rivières pourpres, et pourtant un film assez captivant, avec de superbes images surtout.
L’histoire : Grégoire de Fronsac (et pourquoi pas de Pommerol ?), naturaliste, bel esprit sans excès, arrive de Paris à Mende pour naturaliser la bête qui sème la terreur une fois qu’on l’aura prise. Il arrive avec un indien qu’il a ramené de ses expéditions en Nouvelle France. Il loge au château d’Apcher. Le terrain des exactions de la bête est d’ailleurs assez familier à votre diariste, puisqu’on est en pleine Margeride. On cause donc du mont Mouchet à tire-larigot ; Apcher vient sans doute de St Chély du même nom, etc. Mende est un peu loin de tout cela.
Enfin bref, le naturaliste est présenté à la société du coin, une dizaine de notables complexés par tout ce qui vient de Paris. Ces notables m’ont rappelé bien des personnes : ils forment une coterie, « on est bien entre nous », fermée aux étrangers. Ils font pour la plupart figure d’être pieux mais n’ont rien à cirer de la messe. Leur esprit est d’une étroitesse caractéristique. Bien entendu, la présence de l’indien permet un couplet discret sur le respect de l’autre ; un couplet plus lourd sur « ont-ils une âme ? » (- Si, si, on en a même accouplé avec des blancs, ils font des enfants, ce sont bien des humains. – Pf ! Cela ne veut rien dire !) L’indien a un double rôle : manifester la bassesse des notables, et voir l’invisible. Classique.
La bébête, pendant ce temps, se voit de plus en plus. C’est comme une espèce de porc-épic géant croisé avec un dinosaure pataud, et qui serait de très mauvaise humeur parce qu’on lui a fait renifler du poivre. L’auteur se paye même quelques scènes se rapportant directement à Alien. Donc la bête tue, et tue sans arrêt. Pendant ce temps, les culs-terreux du coin, qui ressemblent plus à des hommes de Genghis Khan qu’à d’honnêtes Auvergnats, se bastonnent avec Mani, l’indien. (Non, son patronyme n’est pas Kéen.)
Après un bout de temps, le roi, menacé politiquement par cette affaire, envoie un de ses soldats pour capturer la bête. Ce dernier revient avec un loup, que Fronsac, par ordre, falsifie pour en faire un gros méchant loup, et poum, l’affaire est enterrée, et Fronsac envoyé en Afrique pour qu’il ne cause pas trop.
Mais il revient clandestinement en Gévaudan parce qu’il est persuadé que la bête n’est pas un loup. Là, il découvre la vérité : c’est une créature dans une cuirasse, dirigée par l’abbé du coin, que la lecture de l’Apocalypse a un peu perturbé. L’abbé s’est monté une sorte de Sodalitium pianum à lui seul pour punir Louis XV de ne pas être assez sévère avec les philosophes. Son plan est de répandre plein de bêtes sur tout le pays, comme preuve de l’apocalypse qui commence, parce que le très-chrétien Louis XV ne l’a pas été assez. Les notables du coin en font tous partie, de même qu’une bonne poignée de paysans : c’est vraiment la conjuration de tradiland-sur-Province. Mani se fait tuer dans l’histoire, et Fronsac, peinturluré en indien, revient le venger et en zigouille un grand nombre avant d’être pris à son tour et, euh… je ne me souviens plus de la fin.
Bref, c’est Angélique meets Matrix meets Alien meets Mad Max meets Sergio Leone meets Tim Burton meets John Woo. Un sacré fourre-tout encore plus invraisemblable que les Rivières pourpres, et pourtant un film assez captivant, avec de superbes images surtout.
Cinéma : Billy Eliot, de ?
Billy Elliot, du cinéaste socio-anglais du moment. Précédé par une bande annonce de Billy Elliot où le public, larmoyant à la sortie d’un cinéma, explique que c’est un film qui réconcilie avec l’humanité, etc. On avait déjà dit cela du Facteur à l’époque. Nos bons spectateurs se sentant donc meilleurs, on peut aborder une autre bande-annonce où deux gamins de Manchester en ère Thatcherienne et en pleine dépression ne savent plus quoi inventer pour se payer un abonnement à l’année pour les matches de football. Ahem, hem, le cinéma social anglais est en train de partir gravement en couille. D’accord, il y avait Trainspotting et surtout The full monty qui riaient jaune des années 80 en prenant le point de vue de l’ouvrier au chômage (en Ecosse pour l’un, à Sheffield pour l’autre), avec le cortège de misère, de bière et de papier peint fleuri qui va bien avec.
Mais là, encore la « dure réalité sociale », mais pour une histoire de places au stade ? On dirait que les années Thatcher deviennent le Viet-Nam des Anglais.
Billy Elliot, donc. Ca se passe en Angleterre dans les années 80. Non, je ne blague pas. Dans un patelin miteux des environs de Durham. Réaction de Nelly : « ah oui, superbe cathédrale ! » Chose amusante, un des personnages du film aura exactement cette réaction. Le héros, Billy Elliot, est presque un extra-terrestre, un garçon qui a de la classe parachuté au milieu des corons. En période de grève. Et son père est un gréviste farouche (non ???) et son grand frère aussi (non ?!?) Pendant ce temps, Billy ne veut pas faire de la boxe mais danser. Et il y arrive fort bien. Bien entendu, le père finit par découvrir ça, et s’effondre (« mon fils est pédé ») puis réagit violemment. C’est un peu caricatural, d’autant que le père en question a, bien évidemment, un cœur d’or sous des air d’ours. En fin de compte, Billy a une audition à Londres. Séquence « choc des cultures » obligatoire. Tiens, ils n’ont pas le même accent. Et ils l’appellent William. Et c’est là qu’un des autres candidats pose la fameuse question sur la cathédrale de Durham.(«Never been there»)
Comme la scolarité londonienne coûte cher, le père va devoir se remettre à travailler et passer pour un jaune. (C’était la séquence sacrifice), etc, etc. Final à Londres quinze ans plus tard où, devant un parterre de pédés branchés, Billy, qui est devenu un des grands noms de la danse, brille dans le Lac des Cygnes.
On l’aura compris, ce n’est pas tant un film social qu’une comédie musicale. Greffons Fred Astaire sur des mineurs en grève et voyons si ça prend. Force m’est de constater que la seule chose qui prend, ce sont les séquences musicales. Il y a une charge de bobbies avec arrivée de la cavalerie sur fond de London Calling (pour mes lecteurs qui ne savent pas, c’est The Clash, 1983, l’une des rares choses punks à avoir survécu). Un peu manipulateur, certes, mais bien réglé. Et surtout les scènes ou Billy danse, qui sont, et de loin, le clou du film. Par bonheur, il y en a beaucoup, et Jamie Bell, le jeune acteur, semble très doué, et d’une bonne humeur contagieuse. Foin donc des passages trop nombreux où l’on veut nous faire pleurer sur le sort des mineurs, les « pourquoi tant de haine » répétitifs ; le message du film, peut être involontaire, c’est que lorsque la musique parle et nous ravit, tout le reste se tait. C’est encore une preuve de ces rapports privilégiés qu’entretient la musique avec l’au-dessus, et le tour de force est d’avoir trouvé un acteur qui n’affadit pas ce qui est pourtant avant tout une expérience personnelle.
Le reste n’est pas crédible. On a un côté « social » accentué, mais toute la famille Elliot semble sortir d’un quartier cossu de Londres et s’être affublé de vestes en jean pour les besoins du film. Billy est charmant, le père a une bonne tête de gars qui a des principes et ne rigole pas avec l’honneur, quand au grand frère, on a du mal à l’imaginer en syndicaliste agité plus de quelques secondes.
De Fred Astaire et des mineurs en grève, c’est Fred Astaire qui gagne largement, et le goût avec lui. Dans un tel milieu, c’est surprenant. Mais oubliez les blablas sur « le film qui rend meilleur et réconcilie avec l’humanité » : si c’était vraiment le cas, je n’aurais pas aimé.
Mais là, encore la « dure réalité sociale », mais pour une histoire de places au stade ? On dirait que les années Thatcher deviennent le Viet-Nam des Anglais.
Billy Elliot, donc. Ca se passe en Angleterre dans les années 80. Non, je ne blague pas. Dans un patelin miteux des environs de Durham. Réaction de Nelly : « ah oui, superbe cathédrale ! » Chose amusante, un des personnages du film aura exactement cette réaction. Le héros, Billy Elliot, est presque un extra-terrestre, un garçon qui a de la classe parachuté au milieu des corons. En période de grève. Et son père est un gréviste farouche (non ???) et son grand frère aussi (non ?!?) Pendant ce temps, Billy ne veut pas faire de la boxe mais danser. Et il y arrive fort bien. Bien entendu, le père finit par découvrir ça, et s’effondre (« mon fils est pédé ») puis réagit violemment. C’est un peu caricatural, d’autant que le père en question a, bien évidemment, un cœur d’or sous des air d’ours. En fin de compte, Billy a une audition à Londres. Séquence « choc des cultures » obligatoire. Tiens, ils n’ont pas le même accent. Et ils l’appellent William. Et c’est là qu’un des autres candidats pose la fameuse question sur la cathédrale de Durham.(«Never been there»)
Comme la scolarité londonienne coûte cher, le père va devoir se remettre à travailler et passer pour un jaune. (C’était la séquence sacrifice), etc, etc. Final à Londres quinze ans plus tard où, devant un parterre de pédés branchés, Billy, qui est devenu un des grands noms de la danse, brille dans le Lac des Cygnes.
On l’aura compris, ce n’est pas tant un film social qu’une comédie musicale. Greffons Fred Astaire sur des mineurs en grève et voyons si ça prend. Force m’est de constater que la seule chose qui prend, ce sont les séquences musicales. Il y a une charge de bobbies avec arrivée de la cavalerie sur fond de London Calling (pour mes lecteurs qui ne savent pas, c’est The Clash, 1983, l’une des rares choses punks à avoir survécu). Un peu manipulateur, certes, mais bien réglé. Et surtout les scènes ou Billy danse, qui sont, et de loin, le clou du film. Par bonheur, il y en a beaucoup, et Jamie Bell, le jeune acteur, semble très doué, et d’une bonne humeur contagieuse. Foin donc des passages trop nombreux où l’on veut nous faire pleurer sur le sort des mineurs, les « pourquoi tant de haine » répétitifs ; le message du film, peut être involontaire, c’est que lorsque la musique parle et nous ravit, tout le reste se tait. C’est encore une preuve de ces rapports privilégiés qu’entretient la musique avec l’au-dessus, et le tour de force est d’avoir trouvé un acteur qui n’affadit pas ce qui est pourtant avant tout une expérience personnelle.
Le reste n’est pas crédible. On a un côté « social » accentué, mais toute la famille Elliot semble sortir d’un quartier cossu de Londres et s’être affublé de vestes en jean pour les besoins du film. Billy est charmant, le père a une bonne tête de gars qui a des principes et ne rigole pas avec l’honneur, quand au grand frère, on a du mal à l’imaginer en syndicaliste agité plus de quelques secondes.
De Fred Astaire et des mineurs en grève, c’est Fred Astaire qui gagne largement, et le goût avec lui. Dans un tel milieu, c’est surprenant. Mais oubliez les blablas sur « le film qui rend meilleur et réconcilie avec l’humanité » : si c’était vraiment le cas, je n’aurais pas aimé.
Cinéma : Fight Club, de David Fincher
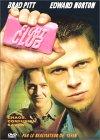
Encore un film à l’humour décalé comme savent nous en servir nos amis US. Jack est un gars middle-class standard, appartement, meubles Ikea, consumérisme léger. Il faut savoir qu’Ikea, aux States, a une réputation qui n’est pas encore parvenue ici, celle de stéréotyper les goûts en matière de mobilier tout en prétendant faire ressortir l’individualité. En gros, les meubles de série qui disent « tu es quelqu’un de différent ». Ikea partage cette responsabilité avec Old Navy (une marque de vêtements très présentables, qui ne semble pas implantée ici) et… Apple.
Voilà donc notre Jack défini en gros traits par sa petite vie tranquille. Mais il souffre d’insomnie, et n’est jamais réellement réveillé ni réellement endormi. Pour se soigner, il pleure ; et pour pleurer, il va dans toutes les thérapies de groupe possible, à la Alcooliques Anonymes. Scènes américanissimes hilarantes avec les hommes à qui on a retiré les testicules ; avec du mystico-gazeux hindouisant : « vous rentrez dans votre caverne, vous rencontrez votre animal-totem… » Un jour, à cause d’une autre touriste, il ne peut plus pleurer et retrouve ses insomnies. Il rencontre alors Tyler Durden, représentant en savon, qui est son exact contraire : assuré, aventureux, méprisant absolument le confort, ingénieux, etc. Tyler prend de l’ascendant sur lui ; et un soir ils créent le Fight Club, un club clandestin dont les membres se battent. Tyler semble prendre à cœur de « faire un homme » de Jack. Par le combat d’abord, par des exercices imposés ensuite (commencer un combat et perdre volontairement), pas la vie en commun dans une maison vétuste enfin. Tyler vit de la vente de son savon, fabriqué artisanalement avec la graisse volée dans les poubelles des cliniques à liposuccion. (La critique a hurlé, y voyant une référence même pas honteuse aux camps de la mort.) « Comme ça, dit Tyler, on revend leur gros cul à ces rombières. »
Les Fight Clubs se répandent dans le monde, et Tyler, toujours en quête de « libérer » Jack, recrute une armée. Qu’il habille de chemises noires (la critique hurle à nouveau). Dans quel but ? Jack n’arrive pas à le savoir. Ce coup-ci, il est en dehors du complot. L’armée du « Project Mayhem » se livre à des actes de plus en plus stupides, certains même dangereux. A force de voyager à droite et à gauche, Jack finit par comprendre que Tyler n’est qu’une création de son cerveau. Jack est schizophrène ; son insomnie le prive de mémoire, et Tyler n’est que l’homme qu’il aurait aimé être – et qu’il est parfois. Il se livre à la police, mais tous les policiers font partie du « Project Mayhem » et le relâchent avec égards. Finalement, Tyler machine de faire sauter tous les systèmes informatiques des grandes banques pour effacer le concept de monnaie de la surface du globe (admettons) – puis, pour échapper à ce double qu’il ne supporte plus, Jack se suicide sur fond de i|Financial District]i qui explose. Joli.
David Fincher n’est pas un imbécile, et l’on peut se douter qu’il ne faut pas prendre tout cela au premier degré. Pourtant, le dossier de presse accompagnant le DVD nous montre que les critiques US ne sont guère plus futés que les notres. Imaginez un peu : notre monde menacé par une société secrète anti-consumériste, des gens prêts à se battre dans la rue pour le plaisir. « C’est, a dit un peu trop vite un plumitif, la résurgence de l’idéologie SA et SS. » Retourne à tes livres d’histoire, mon grand, et achète des lunettes. On pourrait dire aussi que c’est la résurgence de l’idéologie monastique : la vie dans la maison vétuste a tout du vœu de pauvreté – mais dans tout le film, le salut ne vient pas de Dieu mais de l’auto-destruction. Fight Club est un film nihiliste, où il ne s’agit que de démolir, et où l’on n’oublie pas que le message provient d’un des cinéastes les mieux payés d’Hollywood : si c’est gros, si c’est excessif, c’est volontaire : on n’allait tout de même pas être sérieux, non ? En bref, un excellent divertissement qui fait travailler les neurones.
Voilà donc notre Jack défini en gros traits par sa petite vie tranquille. Mais il souffre d’insomnie, et n’est jamais réellement réveillé ni réellement endormi. Pour se soigner, il pleure ; et pour pleurer, il va dans toutes les thérapies de groupe possible, à la Alcooliques Anonymes. Scènes américanissimes hilarantes avec les hommes à qui on a retiré les testicules ; avec du mystico-gazeux hindouisant : « vous rentrez dans votre caverne, vous rencontrez votre animal-totem… » Un jour, à cause d’une autre touriste, il ne peut plus pleurer et retrouve ses insomnies. Il rencontre alors Tyler Durden, représentant en savon, qui est son exact contraire : assuré, aventureux, méprisant absolument le confort, ingénieux, etc. Tyler prend de l’ascendant sur lui ; et un soir ils créent le Fight Club, un club clandestin dont les membres se battent. Tyler semble prendre à cœur de « faire un homme » de Jack. Par le combat d’abord, par des exercices imposés ensuite (commencer un combat et perdre volontairement), pas la vie en commun dans une maison vétuste enfin. Tyler vit de la vente de son savon, fabriqué artisanalement avec la graisse volée dans les poubelles des cliniques à liposuccion. (La critique a hurlé, y voyant une référence même pas honteuse aux camps de la mort.) « Comme ça, dit Tyler, on revend leur gros cul à ces rombières. »
Les Fight Clubs se répandent dans le monde, et Tyler, toujours en quête de « libérer » Jack, recrute une armée. Qu’il habille de chemises noires (la critique hurle à nouveau). Dans quel but ? Jack n’arrive pas à le savoir. Ce coup-ci, il est en dehors du complot. L’armée du « Project Mayhem » se livre à des actes de plus en plus stupides, certains même dangereux. A force de voyager à droite et à gauche, Jack finit par comprendre que Tyler n’est qu’une création de son cerveau. Jack est schizophrène ; son insomnie le prive de mémoire, et Tyler n’est que l’homme qu’il aurait aimé être – et qu’il est parfois. Il se livre à la police, mais tous les policiers font partie du « Project Mayhem » et le relâchent avec égards. Finalement, Tyler machine de faire sauter tous les systèmes informatiques des grandes banques pour effacer le concept de monnaie de la surface du globe (admettons) – puis, pour échapper à ce double qu’il ne supporte plus, Jack se suicide sur fond de i|Financial District]i qui explose. Joli.
David Fincher n’est pas un imbécile, et l’on peut se douter qu’il ne faut pas prendre tout cela au premier degré. Pourtant, le dossier de presse accompagnant le DVD nous montre que les critiques US ne sont guère plus futés que les notres. Imaginez un peu : notre monde menacé par une société secrète anti-consumériste, des gens prêts à se battre dans la rue pour le plaisir. « C’est, a dit un peu trop vite un plumitif, la résurgence de l’idéologie SA et SS. » Retourne à tes livres d’histoire, mon grand, et achète des lunettes. On pourrait dire aussi que c’est la résurgence de l’idéologie monastique : la vie dans la maison vétuste a tout du vœu de pauvreté – mais dans tout le film, le salut ne vient pas de Dieu mais de l’auto-destruction. Fight Club est un film nihiliste, où il ne s’agit que de démolir, et où l’on n’oublie pas que le message provient d’un des cinéastes les mieux payés d’Hollywood : si c’est gros, si c’est excessif, c’est volontaire : on n’allait tout de même pas être sérieux, non ? En bref, un excellent divertissement qui fait travailler les neurones.
Cinéma : Alien, par Ridley Scott
L’histoire : un vaisseau spatial commercial intercepte une transmission inconnue provenant d’une planète inexplorée. Ils se portent au secours d’éventuels survivants, mais ne réussissent qu’à ramener l’un des leurs avec une grosse araignée jaune collé à la figure. (L’imbécile l’avait bien cherché : tien, un œuf qui s’ouvre. Qu’est-ce que ça fait si je touche ce qu’il y a dedans ? Vlam ! Ah bon.) Au mépris de toutes les règles de quarantaine, on le laisse rentrer… mais l’araignée disparaît. Quelques jours après, un petit monstre – qui va devenir l’un des plus célèbres du cinéma du XXème siècle – sort de son ventre (en le tuant au passage). Il est laid, il a des crocs impressionnants, et surtout, il a très faim. Et il grandit en quelques heures, et se cache quelque part dans le vaisseau, d’où il décime l’équipage. Violemment, bien sûr. Le spectateur est haletant : qui va survivre ? Il ne reste bientôt plus que Ripley (Sigourney Weaver) et un chat. ( - ploink ! – C’est toi qui a fait ce bruit, minou ? – Groooaaa. – Comment ça, groaaaa ? ) Autant on ne craint rien pour le chat, autant la femme… Mais Ripley arrivera à se débarrasser de la bestiole – voyez le film pour savoir comment.
Alien ne vaut pas tant par son scénario, assez simple comme on le voit, que par la manière de le filmer et d’en faire l’un des rares films d’épouvante qui font réellement peur. Le décor est familier : c’est un vaisseau un peu rétro à la 2001. Mais les habitants ne sont pas les mêmes. Et la bestiole n’est pas ouverte au dialogue. Le grand art est d’avoir fait de tout cela un spectacle captivant, souvent effrayant, accompagné d’une excellente musique. Je crois bien que c’était la première réussite de Ridley Scott à l’écran, avant même Blade Runner.
Mon rêve : voir comment l’alien se débrouillerait pour rester en équilibre sur un parquet savonné.
Alien ne vaut pas tant par son scénario, assez simple comme on le voit, que par la manière de le filmer et d’en faire l’un des rares films d’épouvante qui font réellement peur. Le décor est familier : c’est un vaisseau un peu rétro à la 2001. Mais les habitants ne sont pas les mêmes. Et la bestiole n’est pas ouverte au dialogue. Le grand art est d’avoir fait de tout cela un spectacle captivant, souvent effrayant, accompagné d’une excellente musique. Je crois bien que c’était la première réussite de Ridley Scott à l’écran, avant même Blade Runner.
Mon rêve : voir comment l’alien se débrouillerait pour rester en équilibre sur un parquet savonné.
Télévision : la vague de « reality shows » aux USA
Je lis sur salon.com le résumé des derniers reality shows américains. C’est passionnant. On savait déjà que Big Brothe était un gigantesque flop là-bas, très loin du voyeurisme que l’on craignait (les noirs, puis les vieux, puis les excités s’étaient fait éjecter de la maison, il ne restait plus que des américains moyens totalement fadasses qui s’ennuyaient horriblement. Audimat catastrophique.)
Voilà maintenant The Mole (la taupe). Dix joueurs sont promenés à travers le monde pour passer des épreuves collectives. S’ils gagnent les épreuves, ils gagnent de l’argent. Mais l’un d’eux est une taupe au service des producteurs, qui se dévoue pour tout faire capoter. Ils doivent deviner qui c’est. Celui qui « chauffe » le moins est viré, chaque semaine.
The mole est parti pour être très ennuyeux. Je lis qu’une des épreuves consistait à sortir d’un labyrinthe : personne ne l’a réussie. Ca promet.
I[Temptation Island]i, en revanche, semble bien plus drôle. On prend quatre couples, on les sépare par sexe, et on met tout ça dans deux parties séparées d’une île des Caraïbes. Les quatre hommes avec six top models féminins peu farouches et payés pour l’être; et l’inverse pour les femmes : six mâles qui ne demandent qu’une chose : les faire passer à la casserole. Enjeu : rester fidèle à son conjoint au milieu de tout ça. Si on reste fidèle, $$$, sinon, rien. Comme le dit le journaliste de salon.com : « Babealicious women! Hunkariffic guys! Doomed couples!”
Le site résume donc les épisodes en cours, avec des commentaires féroces. Présentation des couples : « Shannon and Andy have been together five years. How or why is beyond us.” Et ça : “Billy is young. Billy is innocent. Billy is in love. Billy is screwed.” Apparemment, la motivation de 80% des participants est de tester la fidélité de leur conjoint. Commentaire de salon : « Il semblerait qu’elle croie que figurer dans un show télévisé est une bonne méthode pour mesurer la tendance à l’infidélité de son bien-aimé. Nous sentons diffusément qu’il y a une faille dans sa logique, mais nous ne pouvons pas dire où précisément. »
« Des garçons, seul Billy est différent. Billy a peur que Mandy le quitte pour quelqu’un d’autre, «alors que je l’aime à la folie. » Nous adorons Billy. Nous soutenons Billy de tout notre cœur. Mais il est visiblement foutu. » Mandy explique ensuite que Billy « ne lui a jamais donné de signe d’infidélité » et qu’elle en aimerait quelques-uns.
Après cela, débarquement des top-models. Parade des célibataires mecs devant les épouses, et des célibataires nanas devant les maris. La partie opposée dit « pf ! » Une des nanas prétend être médecin ET ancien mannequin pour Playboy. « Les gars ont des noms dans le genre de Dano ou Ace. »
Puis chaque mari choisit un célibataire à qui il interdit de rencarder sa femme, et réciproquement. Mais ils pourront se parler. Ces proscriptions semblent montrer que les conjoints connaissent assez mal leurs goûts réciproques. Puis le soir, après que les uns aient frayés avec les autres, ce ne sont que conversations du genre « au moins il a du respect pour les femmes, LUI. » C’est les Bidochon à la plage.
Après le repas du soir, les maris vont se saôuler avec les pétasses, alors que les épouses consolent l’une d’elles qui sanglote. Commentaire final : « c’est une des choses les plus dérangées que nous ayons jamais vues… et hélas, ce n’est qu’une seule fois par semaine. »
Voilà maintenant The Mole (la taupe). Dix joueurs sont promenés à travers le monde pour passer des épreuves collectives. S’ils gagnent les épreuves, ils gagnent de l’argent. Mais l’un d’eux est une taupe au service des producteurs, qui se dévoue pour tout faire capoter. Ils doivent deviner qui c’est. Celui qui « chauffe » le moins est viré, chaque semaine.
The mole est parti pour être très ennuyeux. Je lis qu’une des épreuves consistait à sortir d’un labyrinthe : personne ne l’a réussie. Ca promet.
I[Temptation Island]i, en revanche, semble bien plus drôle. On prend quatre couples, on les sépare par sexe, et on met tout ça dans deux parties séparées d’une île des Caraïbes. Les quatre hommes avec six top models féminins peu farouches et payés pour l’être; et l’inverse pour les femmes : six mâles qui ne demandent qu’une chose : les faire passer à la casserole. Enjeu : rester fidèle à son conjoint au milieu de tout ça. Si on reste fidèle, $$$, sinon, rien. Comme le dit le journaliste de salon.com : « Babealicious women! Hunkariffic guys! Doomed couples!”
Le site résume donc les épisodes en cours, avec des commentaires féroces. Présentation des couples : « Shannon and Andy have been together five years. How or why is beyond us.” Et ça : “Billy is young. Billy is innocent. Billy is in love. Billy is screwed.” Apparemment, la motivation de 80% des participants est de tester la fidélité de leur conjoint. Commentaire de salon : « Il semblerait qu’elle croie que figurer dans un show télévisé est une bonne méthode pour mesurer la tendance à l’infidélité de son bien-aimé. Nous sentons diffusément qu’il y a une faille dans sa logique, mais nous ne pouvons pas dire où précisément. »
« Des garçons, seul Billy est différent. Billy a peur que Mandy le quitte pour quelqu’un d’autre, «alors que je l’aime à la folie. » Nous adorons Billy. Nous soutenons Billy de tout notre cœur. Mais il est visiblement foutu. » Mandy explique ensuite que Billy « ne lui a jamais donné de signe d’infidélité » et qu’elle en aimerait quelques-uns.
Après cela, débarquement des top-models. Parade des célibataires mecs devant les épouses, et des célibataires nanas devant les maris. La partie opposée dit « pf ! » Une des nanas prétend être médecin ET ancien mannequin pour Playboy. « Les gars ont des noms dans le genre de Dano ou Ace. »
Puis chaque mari choisit un célibataire à qui il interdit de rencarder sa femme, et réciproquement. Mais ils pourront se parler. Ces proscriptions semblent montrer que les conjoints connaissent assez mal leurs goûts réciproques. Puis le soir, après que les uns aient frayés avec les autres, ce ne sont que conversations du genre « au moins il a du respect pour les femmes, LUI. » C’est les Bidochon à la plage.
Après le repas du soir, les maris vont se saôuler avec les pétasses, alors que les épouses consolent l’une d’elles qui sanglote. Commentaire final : « c’est une des choses les plus dérangées que nous ayons jamais vues… et hélas, ce n’est qu’une seule fois par semaine. »
Tourisme : le Mont St Michel, printemps 2001

Arrivée au Manoir de la Roche-Torin, mon hôtel choisi sur Internet. Bon accueil, ambiance très calme (c'est un relais du silence) et qualité des prestations qui le fait se rapprocher de notre hôtel de rêve à Interlaken en 90. La salle de bains est bien garnie, il y a même lime à ongles et chiffon pour les chaussures. Je m'abandonne dans les bras de Jacques Uzzi. Pourquoi n'a-t-on pas cela chez soi? Ma chambre est spacieuse, cheminée, commode avec glace, grand placard : il y a de quoi se sentir chez soi.
Dîner le soir : soupe à la ciboulette (fade), agneau de pré sale (fameux) et sablés à la framboise et rhubarbe. Le tout accompagné d'un verre de Bordeaux encore tannique malgré ses sept ans. Une nana à une table voisine est en robe de soirée. Heureusement, une famille belge habillée normalement vient rétablir l'équilibre. Le fils, un peu gros, ne manque pas d'esprit. Il dit au serveur "mes parents sont graves" - il exagère. Puis il raconte comment une japonaise de ses connaissances, la première fois qu'elle avait vu arriver un rince-doigts, l'avait bu!
samedi
Visite du Mont St Michel. D'abord mes dévotions chez la Mère Poulard. Pour un tarif plus que parisien, je peux manger des huîtres de Cancale, puis la fameuse mousse de polyuréthane, et enfin des beignets au camembert. Et quel camembert! Le tout est arrosé d'un Quincy 99. Ce doit être un vin de la Loire. Malgré ma réserve pour les blancs secs de ce genre, je dois dire qu'il se marie bien avec tout. Addition horrificque.
Au mur, des portraits de tous les hôtes de marque de la célèbre faiseuse d'omelettes. Cela va d'Edouard VII à Yves Saint-Laurent (le mieux habillé de tous) en passant par Trotsky et les premiers astronautes à avoir marché sur la Lune.
Puis promenade sur les remparts. Le Mont est essentiellement un rocher, de pente un peu plus douce au sud, sur lequel on a d'abord construit une abbaye, puis reconstruit plusieurs fois… et un village s'est greffé au sud. Certaines parties du village ne sont pas très vieilles. Ce qui est fabuleux, c'est l'architecture des maisons, l'unité qui s'en dégage. Des murs en grosses pierres de granite apparentes, d'autres couverts de lauzes en bois, d'autres encore à colombages. Hélas, le rez-de-chaussée est presque toujours occupé par des magasins de souvenirs (casquette de capitaine au long cours, pull rayé, bachi, si vous voyez ce que je veux dire) qui rappellent, hélas!, ceux de Lourdes. L'espace rare au Mont n'empêche pas des jardins de figurer ça et là. Après bien de l'ascension, un escalier se dérobe sous une poterne : c'est l'entrée de l'abbaye et le début des émerveillements. De dehors déjà, la construction sur sa face sud (les logis abbatiaux) est impressionnante. Dedans, un large escalier, enserré entre deux murailles gothiques de dizaines de mètres de hauteur, transporte réellement dans un autre monde, que l'on ne quitte plus de toute la visite. C'est l'abbaye du Nom de la Rose, voire mieux, un décor tel qu'on se demande s'il existe vraiment tant il est extraordinaire. Je passe sur les points de vue, la basilique romane, le cloître suspendu, le réfectoire (dont s'est inspiré un des réfectoires de Randol), l'escalier sur un des arc-boutants, la vue sur la baie, tout, absolument, serait à mentionner, et mes descriptions ne resteraient que des paroles bien ternes en face de ce qui passait à juste titre au Moyen-Age pour une incarnation, une impétration plutôt, de la Jérusalem céleste. Curieusement, le nombre des moines n'a jamais dépassé 60, ce qui est peu. Trop beau, le monastère? Peut-être.
Les rapprochements que je peux faire vont surprendre : l'abbaye m'évoque la cité des nuages de la guerre des étoiles; ou encore un jeu vidéo : le style change à chaque nouvelle pièce : on croirait presque qu'il y a des indices à découvrir. Pour les archéologues, c'est aussi un émerveillement : tous les styles architecturaux religieux sont là ou presque, des voûtes en brique à la romaine (ND sous terre) au chœur de l'abbatiale en gothique flamboyant. Bref, on ne ressort pas de là indemne.
Dîner le soir : soupe à la ciboulette (fade), agneau de pré sale (fameux) et sablés à la framboise et rhubarbe. Le tout accompagné d'un verre de Bordeaux encore tannique malgré ses sept ans. Une nana à une table voisine est en robe de soirée. Heureusement, une famille belge habillée normalement vient rétablir l'équilibre. Le fils, un peu gros, ne manque pas d'esprit. Il dit au serveur "mes parents sont graves" - il exagère. Puis il raconte comment une japonaise de ses connaissances, la première fois qu'elle avait vu arriver un rince-doigts, l'avait bu!
samedi
Visite du Mont St Michel. D'abord mes dévotions chez la Mère Poulard. Pour un tarif plus que parisien, je peux manger des huîtres de Cancale, puis la fameuse mousse de polyuréthane, et enfin des beignets au camembert. Et quel camembert! Le tout est arrosé d'un Quincy 99. Ce doit être un vin de la Loire. Malgré ma réserve pour les blancs secs de ce genre, je dois dire qu'il se marie bien avec tout. Addition horrificque.
Au mur, des portraits de tous les hôtes de marque de la célèbre faiseuse d'omelettes. Cela va d'Edouard VII à Yves Saint-Laurent (le mieux habillé de tous) en passant par Trotsky et les premiers astronautes à avoir marché sur la Lune.
Puis promenade sur les remparts. Le Mont est essentiellement un rocher, de pente un peu plus douce au sud, sur lequel on a d'abord construit une abbaye, puis reconstruit plusieurs fois… et un village s'est greffé au sud. Certaines parties du village ne sont pas très vieilles. Ce qui est fabuleux, c'est l'architecture des maisons, l'unité qui s'en dégage. Des murs en grosses pierres de granite apparentes, d'autres couverts de lauzes en bois, d'autres encore à colombages. Hélas, le rez-de-chaussée est presque toujours occupé par des magasins de souvenirs (casquette de capitaine au long cours, pull rayé, bachi, si vous voyez ce que je veux dire) qui rappellent, hélas!, ceux de Lourdes. L'espace rare au Mont n'empêche pas des jardins de figurer ça et là. Après bien de l'ascension, un escalier se dérobe sous une poterne : c'est l'entrée de l'abbaye et le début des émerveillements. De dehors déjà, la construction sur sa face sud (les logis abbatiaux) est impressionnante. Dedans, un large escalier, enserré entre deux murailles gothiques de dizaines de mètres de hauteur, transporte réellement dans un autre monde, que l'on ne quitte plus de toute la visite. C'est l'abbaye du Nom de la Rose, voire mieux, un décor tel qu'on se demande s'il existe vraiment tant il est extraordinaire. Je passe sur les points de vue, la basilique romane, le cloître suspendu, le réfectoire (dont s'est inspiré un des réfectoires de Randol), l'escalier sur un des arc-boutants, la vue sur la baie, tout, absolument, serait à mentionner, et mes descriptions ne resteraient que des paroles bien ternes en face de ce qui passait à juste titre au Moyen-Age pour une incarnation, une impétration plutôt, de la Jérusalem céleste. Curieusement, le nombre des moines n'a jamais dépassé 60, ce qui est peu. Trop beau, le monastère? Peut-être.
Les rapprochements que je peux faire vont surprendre : l'abbaye m'évoque la cité des nuages de la guerre des étoiles; ou encore un jeu vidéo : le style change à chaque nouvelle pièce : on croirait presque qu'il y a des indices à découvrir. Pour les archéologues, c'est aussi un émerveillement : tous les styles architecturaux religieux sont là ou presque, des voûtes en brique à la romaine (ND sous terre) au chœur de l'abbatiale en gothique flamboyant. Bref, on ne ressort pas de là indemne.
Cinéma : Magnolia, de P.T. Anderson
Vu récemment : Magnolia en DVD. Un beau film, très esthétisant, qui prend le parti de saisir le spectateur dans son fauteuil, de lui demander de se laisser faire, et de le promener dans des histoires entrecroisées pendant trois heures sans que l'attention baisse une seule fois. L'attention est soutenue par toutes sortes de trucs, des raccords entre plans, une musique excellente, des suspenses, de l'humour. On sent déjà que le film n'est pas conventionnel rien qu'en voyant les cinq premières minutes avant le générique qui, à partir d'événements invraisemblables et qui devraient faire rire dans un autre contexte, arrive à émouvoir. Ces cinq minutes là sont fameuses et resteront dans les annales du cinéma, je le crois bien. Quant à la scène de "la pluie", à la fin, alors qu'on croît avoir tout vu, elle est stupéfiante. Magnolia n'a pas fait énormément de bruit lors de sa sortie, mais c'est un très bon film.
Restaurant : La Manufacture, à Issy les Moulineaux (92)
Dîner avec JLL à la Manufacture. Salade d’encornets, saumon aux lentilles et au lard (bon !) et la fameuse brioche façon pain perdu, un must. Un apprenti sommelier nous vante, pour aller avec tout (JL a pris du sanglier), un cru d’Afrique du Sud, le domaine Hamilton Russell. Facile à retenir, ce sont deux mathématiciens. Après bien des hésitations (JL n’est pas fana de vin étranger, et pas très fana de vin tout court), nous nous laissons plier au bagout de ce sommelier de 21 ans (ce qu’il dit) et prenons ce qui doit être rien moins qu’un Chassagne-Montrachet de l’hémisphère sud. Bien sûr, ce n’est pas ça, mais le vin (à mon avis 60-70 balles dans le commerce) est une sacrée bonne affaire. Un blanc avec une forte odeur de chêne, et bien corsé, avec un caractère que je n’ai trouvé ailleurs : il a une sacrée personnalité même s’il n’est pas aussi bien dégrossi qu’un grand Bourgogne. L’avis de Nelly : strong buy.
Publicité : scoot.fr

On y voit une groupe de scouts, habillés à peu près à la SUF à qui des personnes variées selon les annonces posent des questions sur un ton fort décalé. Par exemple la petite vieille de 90 berges à qui ils portent les commissions, qui leur demande s’ils ne connaîtraient pas un bar tex-mex qui fait karaoké. Réponse des scouts : « on n’est pas scoot, madame ! » Et ils foutent leur camp. Scoot.fr est en effet un annuaire - c’est ce que nous explique le reste de l’annonce.
Une post-annonce fait réapparaître le chef, entouré de quelques garçons : « abonné SFR, excuse-moi de te tutoyer, tu peux retrouver scoot en composant le 222. » J’adore ce « excuse-moi de te tutoyer » : une grande partie de la mentalité scoute est résumée ici avec brio. Par un publicitaire.
La chose n’a pas eu l’heur de plaire aux Scouts de France, qui se sont retrouvés aujourd’hui au tribunal administratif et sont parvenus à un accord non pécuniaire : scoot.fr arrêtera progressivement sa pub qui tourne autour des scouts.
Les SdF pensent qu’il est indigne d’exploiter à des fins commerciales l’image des scouts, de les ridiculiser, et d’exploiter leur capital-sympathie lié au bénévolat. Et moi, je pense que les Scouts de France sont des imbéciles. A l’heure de Perros-Guirec, ils ne trouvaient rien à redire à ce que leur commissaire général écrive dans l’Humanité, et maintenant, a la vue d’une pub qui fait penser aux SUF, et pas du tout aux gnomes verts rouges et bleus, voilà que l’on monte sur ses grands chevaux. Excuse-moi de te tutoyer, vraiment.
Une post-annonce fait réapparaître le chef, entouré de quelques garçons : « abonné SFR, excuse-moi de te tutoyer, tu peux retrouver scoot en composant le 222. » J’adore ce « excuse-moi de te tutoyer » : une grande partie de la mentalité scoute est résumée ici avec brio. Par un publicitaire.
La chose n’a pas eu l’heur de plaire aux Scouts de France, qui se sont retrouvés aujourd’hui au tribunal administratif et sont parvenus à un accord non pécuniaire : scoot.fr arrêtera progressivement sa pub qui tourne autour des scouts.
Les SdF pensent qu’il est indigne d’exploiter à des fins commerciales l’image des scouts, de les ridiculiser, et d’exploiter leur capital-sympathie lié au bénévolat. Et moi, je pense que les Scouts de France sont des imbéciles. A l’heure de Perros-Guirec, ils ne trouvaient rien à redire à ce que leur commissaire général écrive dans l’Humanité, et maintenant, a la vue d’une pub qui fait penser aux SUF, et pas du tout aux gnomes verts rouges et bleus, voilà que l’on monte sur ses grands chevaux. Excuse-moi de te tutoyer, vraiment.
Cinéma :Aliens le retour, par James Cameron
Aliens. Bonne suite d’ Alien. Avec plein de marines américains. J’adore les films avec des marines Américains. Autant je ne souhaite pas voir un seul militaire français sur un écran (ni en réalité), autant n’importe quel soldat américain sur une toile a tout mon soutien. Que ce soit Full Metal Jacket ou Rambo. C’est sans doute ma manière d’être américanophobe. Dans les films de guerre (ou d’action), ils sont le symbole même du bon droit et de l’efficacité – même si le réalisateur dit le contraire. J’ai un petit faible pour les personnages tout blancs ou tout noirs. Les marines et Dark Vador, donc.
Aliens, c’est « this time, it’s war ! » Et un escadron de marines va donc botter le cul de la vilaine bête avec une puissance de feu hollywoodienne. Mais voilà, la vilaine bête, il n’y en a pas qu’une, et les marines ont beau avoir toutes les qualités (sauf la distinction), il leur arrive un petit Viet-Nam de l’espace. Heureusement, Sigourney Weaver est là. Un film assez efficace de James Cameron (tout juste révélé par Terminator) où ça explose et ça crame comme j’aime. Cameron ne s’embarrasse pas pour nous la jouer second degré et balancer sur la pellicule à peu près tous les stéréotypes du film de guerre, la fille au milieu des vingt gars qui roulent des mécaniques et se jettent des vannes grasses, etc, etc. Le mot à retenir : « badass ». Ce sont tous des « badass ». This ain’t no fucking bullshit, SIR !
Alien 3, après… est un peu plus convenu. Dieu que cette bestiole est agressive
Aliens, c’est « this time, it’s war ! » Et un escadron de marines va donc botter le cul de la vilaine bête avec une puissance de feu hollywoodienne. Mais voilà, la vilaine bête, il n’y en a pas qu’une, et les marines ont beau avoir toutes les qualités (sauf la distinction), il leur arrive un petit Viet-Nam de l’espace. Heureusement, Sigourney Weaver est là. Un film assez efficace de James Cameron (tout juste révélé par Terminator) où ça explose et ça crame comme j’aime. Cameron ne s’embarrasse pas pour nous la jouer second degré et balancer sur la pellicule à peu près tous les stéréotypes du film de guerre, la fille au milieu des vingt gars qui roulent des mécaniques et se jettent des vannes grasses, etc, etc. Le mot à retenir : « badass ». Ce sont tous des « badass ». This ain’t no fucking bullshit, SIR !
Alien 3, après… est un peu plus convenu. Dieu que cette bestiole est agressive