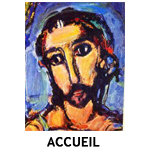Pirates of the Caribbean, de Gore Verbinski.

Un beau casting que ce film : Orlando Bloom (le Legolas du Seigneur des Anneaux), Johnny Depp (demandez à votre petite soeur qui il est) et quelques autres.
Gore Verbinski est un cinéaste talentueux, à n’en pas douter. On peut se souvenir du _Ring_ récemment sorti, et auparavant du Mexicain, une invraisemblable histoire de pistolet où Julia Roberts faisait des scènes de ménage à Brad Pitt, où des plash back en sépia usaient jusqu’à la corde les clichés mexicains, et où James Gandolfini jouait un tueur homosexuel à la poursuite de Julia Roberts – et du pistolet. Touffu, décalé, second degré, un peu incohérent, et un peu long.
Etonnamment, ce sont les mêmes adjectifs qui viennent à l’esprit pour qualifier « Pirates of the Caribbean », quelques années plus tard. Touffu, décalé, second degré, un peu incohérent et un peu long.
L’histoire : un pirate un peu minable poursuit le bateau (pirate) dont il a été le capitaine ; il doit déjouer une malédiction, et emmène une femme avec lui, et… enfin bref, l’histoire n’est pas le plus important. D’ailleurs, on n’y comprend rien. L’essentiel est d’avoir un bateau – et même plusieurs, un petit port colonial un peu étriqué, une femme aventurière, son chevalier servant un peu niais, l’officier à la belle carrière auquel elle doit se marier, et surtout des pirates, plein de pirates. Cerise sur le gâteau, ce sont aussi des fantômes. On a donc des pirates-squelettes, que demander de plus ?
Eh bien, rien. En revanche, on demanderait des choses en moins. Une narration plus ramassée, par exemple, ou un Orlando Bloom avec un peu plus de relief. Il est vrai que Johnny Depp vole la vedette à tout le monde ici ; il campe un pirate bronzé, fluctuant comme une girouette, maniéré au possible, qui ne peut pas parler sans changer son buste trois fois de place avant et rouler des yeux. Qui plus est, le second degré est omniprésent ; on attend Errol Flynn, et on se retrouverait pour peu avec les dialogues de pulp fiction. Donc Johnny Depp fait magistralement son numéro ; et quand Johnny Depp n’est pas sur l’écran, on s’ennuie un peu.
Ce n’est pourtant pas que Gore Verbinski ne sache pas y faire, mais il se fait trop souvent plaisir. La scène d’ouverture, pourtant, est re-mar-quable. Grand plan sur une mer d’huile, zoom sur un bateau ; à la proue, une femme. En quelques secondes, un décor est planté, l’attention du spectateur captivée : on a le cadre, superbe, les questions : que vient faire cette femme ici ? Avant même d’avoir reçu un semblant de réponse, on crie « un homme à la mer » et on repêche un garçon porteur d’une mystérieuse médaille de pirate. Mais la caméra, là encore, ne s’attarde pas, et au-delà du corps, filme des débris, des morceaux de bois, d’autres corps puis élargit brusquement sur le plan d’ensemble d’un bateau en feu en train de couler : le drame s’immisce dans la scène de quiétude et un sentiment de menace paraît ; sans laisser le temps au spectateur de souffler, nouveau travelling et l’on découvre un bateau énorme, hideux, spectral, dressé de voiles noires en lambeaux, arborant le pavillon à tête de mort. C’est le Black Pearl qui fera l’objet d’une large partie de la suite. Mesdames, messieurs, cette ouverture de film, c’est du grand art. Elle pose le décor, annonce les thèmes et ravit le spectateur. Malheureusement, le reste de film sera beaucoup plus inégal.
A voir un samedi soir entre copains.
Gore Verbinski est un cinéaste talentueux, à n’en pas douter. On peut se souvenir du _Ring_ récemment sorti, et auparavant du Mexicain, une invraisemblable histoire de pistolet où Julia Roberts faisait des scènes de ménage à Brad Pitt, où des plash back en sépia usaient jusqu’à la corde les clichés mexicains, et où James Gandolfini jouait un tueur homosexuel à la poursuite de Julia Roberts – et du pistolet. Touffu, décalé, second degré, un peu incohérent, et un peu long.
Etonnamment, ce sont les mêmes adjectifs qui viennent à l’esprit pour qualifier « Pirates of the Caribbean », quelques années plus tard. Touffu, décalé, second degré, un peu incohérent et un peu long.
L’histoire : un pirate un peu minable poursuit le bateau (pirate) dont il a été le capitaine ; il doit déjouer une malédiction, et emmène une femme avec lui, et… enfin bref, l’histoire n’est pas le plus important. D’ailleurs, on n’y comprend rien. L’essentiel est d’avoir un bateau – et même plusieurs, un petit port colonial un peu étriqué, une femme aventurière, son chevalier servant un peu niais, l’officier à la belle carrière auquel elle doit se marier, et surtout des pirates, plein de pirates. Cerise sur le gâteau, ce sont aussi des fantômes. On a donc des pirates-squelettes, que demander de plus ?
Eh bien, rien. En revanche, on demanderait des choses en moins. Une narration plus ramassée, par exemple, ou un Orlando Bloom avec un peu plus de relief. Il est vrai que Johnny Depp vole la vedette à tout le monde ici ; il campe un pirate bronzé, fluctuant comme une girouette, maniéré au possible, qui ne peut pas parler sans changer son buste trois fois de place avant et rouler des yeux. Qui plus est, le second degré est omniprésent ; on attend Errol Flynn, et on se retrouverait pour peu avec les dialogues de pulp fiction. Donc Johnny Depp fait magistralement son numéro ; et quand Johnny Depp n’est pas sur l’écran, on s’ennuie un peu.
Ce n’est pourtant pas que Gore Verbinski ne sache pas y faire, mais il se fait trop souvent plaisir. La scène d’ouverture, pourtant, est re-mar-quable. Grand plan sur une mer d’huile, zoom sur un bateau ; à la proue, une femme. En quelques secondes, un décor est planté, l’attention du spectateur captivée : on a le cadre, superbe, les questions : que vient faire cette femme ici ? Avant même d’avoir reçu un semblant de réponse, on crie « un homme à la mer » et on repêche un garçon porteur d’une mystérieuse médaille de pirate. Mais la caméra, là encore, ne s’attarde pas, et au-delà du corps, filme des débris, des morceaux de bois, d’autres corps puis élargit brusquement sur le plan d’ensemble d’un bateau en feu en train de couler : le drame s’immisce dans la scène de quiétude et un sentiment de menace paraît ; sans laisser le temps au spectateur de souffler, nouveau travelling et l’on découvre un bateau énorme, hideux, spectral, dressé de voiles noires en lambeaux, arborant le pavillon à tête de mort. C’est le Black Pearl qui fera l’objet d’une large partie de la suite. Mesdames, messieurs, cette ouverture de film, c’est du grand art. Elle pose le décor, annonce les thèmes et ravit le spectateur. Malheureusement, le reste de film sera beaucoup plus inégal.
A voir un samedi soir entre copains.
American Wedding (sortie le 15 octobre)

American Wedding est la troisième de la série inégale des American Pie. Le premier du lot, au-delà d’un aspect pipi-caca revendiqué et assumé, présentait une image de l’adolescence américaine moins simpliste qu’on aurait pu le craindre ; les garçons étaient bebêtes mais aussi fragiles et cruels ; les filles attachantes malgré leur air de nunuche ou de on-est-plus-mures-que-vous. Et par-dessus tout cela, il y avait, bien sûr, l’infâme scène de la tarte aux pommes, le père au gros sourcils qui « initie aux choses de la vie » son fils qui en sait déjà bien plus que lui, et le fabuleux passage de l’étudiante tchèque qui se « met à l’aise » devant une webcam, puis est rejointe par un Jason Biggs tellement fébrile qu’il… enfin, vous savez. Le premier, donc, combinait un côté crade et une épaisseur psychologique plus consistante que la moyenne du genre.
Le second, hélas, était un fiasco. Les mêmes personnages revenaient, mais uniquement pour une fête du pipi caca, ce qui rendait tout ce qui n’était pas pipi caca horriblement ennuyeux. Combien de minutes passées à bailler avant de voir – enfin – Jason Biggs confondre la colle UHU et la vaseline.
Le troisième présente un scénario plus développé. On revoit avec plaisir les héros auxquels on est habitué (preuve que le premier avait une réelle consistance, moi j’dis). Cette fois ci, Jim (Jason Biggs) va se marier avec Michelle (la nunuche délurée qui passait ses vacances dans des camps musicaux) ; les amis sont invités, sauf Steve Stifler, jugé vulgaire, embarrassant et un risque de ruine potentiel pour la soirée. Tous sont en effet à la fac, sauf Stifler qui conduit le bus de l’école et entraîne l’équipe de football. Le commentaire social s’arrête d’ailleurs là.
Après une scène hilarante autant que scabreuse où Jim est présenté à ses beaux parents, découvert dans une posture osée avec deux chiens (« a big hardy-har-har », dit un critique), Stifler a tout découvert et s’incruste. Les choses se mettent à mal tourner, et les gags choquants s’empilent sans répit. Jim décide, comme preuve d’amour, de se raser… une région de son corps qui est loin de la tête. Malheureusement, les poils finissent dans la ventilation, qui arrive dans la cuisine, et… à vous d’imaginer.
La vision dans un cinéma de telles scènes est nécessaire : comment pourrait-on se passer des réactions collectives ? Au US, les interdits ne sont pas les mêmes, la réactivité non plus. La scatologie choque bien plus que la pornographie ; la scène scabreuse avec deux chiens était donc un amuse gueule. Mais imaginez désormais que l’anneau de mariage a disparu, qu’on comprenne que c’est un des chiens qui l’a mangé, et qu’il faille… eh bien… le récupérer au plus vite. Grondements dans la salle. Vous pouvez imaginer là encore ce qui se passe ? Détrompez-vous. Par un jeu de quiproquos, Stifler est obligé de faire croire que la crotte est une truffe au chocolat. Je n’en dirai pas plus ; sachez seulement que le point culminant de la scène soulève les cris d’horreur unanimes des spectateurs déjà en train de se tire-bouchonner. Ce n’est peut être pas une scène très profonde ; mais elle est efficace. Y participer au milieu du tumulte des spectateurs new-yorkais n’a pas de prix.
Résumons après cet égarement. Le troisième est-il au niveau du premier ? Non ; les gags y ont la part belle et ne laissent pas la place à grand-chose d’autre ; le troisième est-il aussi mauvais que le second ? Non, par leur audace, les scènes humoristiques ou franchement crades retiennent mieux l’attention du spectateur. Faut-il aller voir ce film ? Oui, de préférence avec une bande de copains dans des salles bien remplies. Faut-il le prendre au sérieux ? Hmmm, laissez-moi réflechir… Non.
Le second, hélas, était un fiasco. Les mêmes personnages revenaient, mais uniquement pour une fête du pipi caca, ce qui rendait tout ce qui n’était pas pipi caca horriblement ennuyeux. Combien de minutes passées à bailler avant de voir – enfin – Jason Biggs confondre la colle UHU et la vaseline.
Le troisième présente un scénario plus développé. On revoit avec plaisir les héros auxquels on est habitué (preuve que le premier avait une réelle consistance, moi j’dis). Cette fois ci, Jim (Jason Biggs) va se marier avec Michelle (la nunuche délurée qui passait ses vacances dans des camps musicaux) ; les amis sont invités, sauf Steve Stifler, jugé vulgaire, embarrassant et un risque de ruine potentiel pour la soirée. Tous sont en effet à la fac, sauf Stifler qui conduit le bus de l’école et entraîne l’équipe de football. Le commentaire social s’arrête d’ailleurs là.
Après une scène hilarante autant que scabreuse où Jim est présenté à ses beaux parents, découvert dans une posture osée avec deux chiens (« a big hardy-har-har », dit un critique), Stifler a tout découvert et s’incruste. Les choses se mettent à mal tourner, et les gags choquants s’empilent sans répit. Jim décide, comme preuve d’amour, de se raser… une région de son corps qui est loin de la tête. Malheureusement, les poils finissent dans la ventilation, qui arrive dans la cuisine, et… à vous d’imaginer.
La vision dans un cinéma de telles scènes est nécessaire : comment pourrait-on se passer des réactions collectives ? Au US, les interdits ne sont pas les mêmes, la réactivité non plus. La scatologie choque bien plus que la pornographie ; la scène scabreuse avec deux chiens était donc un amuse gueule. Mais imaginez désormais que l’anneau de mariage a disparu, qu’on comprenne que c’est un des chiens qui l’a mangé, et qu’il faille… eh bien… le récupérer au plus vite. Grondements dans la salle. Vous pouvez imaginer là encore ce qui se passe ? Détrompez-vous. Par un jeu de quiproquos, Stifler est obligé de faire croire que la crotte est une truffe au chocolat. Je n’en dirai pas plus ; sachez seulement que le point culminant de la scène soulève les cris d’horreur unanimes des spectateurs déjà en train de se tire-bouchonner. Ce n’est peut être pas une scène très profonde ; mais elle est efficace. Y participer au milieu du tumulte des spectateurs new-yorkais n’a pas de prix.
Résumons après cet égarement. Le troisième est-il au niveau du premier ? Non ; les gags y ont la part belle et ne laissent pas la place à grand-chose d’autre ; le troisième est-il aussi mauvais que le second ? Non, par leur audace, les scènes humoristiques ou franchement crades retiennent mieux l’attention du spectateur. Faut-il aller voir ce film ? Oui, de préférence avec une bande de copains dans des salles bien remplies. Faut-il le prendre au sérieux ? Hmmm, laissez-moi réflechir… Non.